


Université Toulouse II le Mirail -- UFR Sciences, espaces et sociétés |
REMERCIEMENTS
Je tiens avant tout à remercier Françoise et Pascal pour les enseignements qu’ils ont pu m’apporter tout au long de la réalisation de ce travail, pour l’accueil qu’ils m’ont réservé et pour le temps qu’ils m’ont consacré.
Merci également à Hugues, sans qui mon travail cartographique ne serait pas l’ombre de ce qu’il est.
Je remercie M. Filleron pour m’avoir guidé dans la réalisation de ce travail.
Merci à Bernadette, Pierre, qui m’ont soutenu tout au long de l’année.
Je tiens ensuite à remercier chaleureusement Muriel, Virginie et Joël pour l’aide précieuse qu’ils ont pu m’apporter.
Je tiens enfin à remercier Paul pour son aide logistique.
TABLE DES MATIERES |
1 : Le sujet d’étude : La Caunette
1.2 : Un territoire aux multiples facettes
1.3 : La sécheresse: élément déterminant
1.3.a : Caractéristiques climatiques
1.3.b : Le couvert végétal
1.3.c : L’agriculture2 : Le phénomène observé : la viticulture
1 : Elaboration d’un système d’information géographique
1.2.a : Choix des documents
1.2.b : Préparation et travaux cartographiques3.2 : Principe de fonctionnement
3.2.a : Bases de données associées
3.2.b : Superpositions et observations
1 : Traitements statistiques à l’échelle de la commune
1.1 : La domination des cépages noirs
2 : Différenciation de plusieurs ensembles
2.1 : Méthode d’interprétation
2.1.a : La place des sols dans le choix des parcelles
2.1.b : Reclassification, vectorisation et croisements de données2.2.a : Le terroir sur schistes
2.2.b : Le terroir sur calcaires durs
2.2.c : Le terroir sur marnes laguno-marines
2.2.d : Le terroir sur calcaires tendres
2.2.e : Le terroir sur marnes gréseuses
2.2.f : Les autres terroirs
INTRODUCTION |
Le Languedoc est réputé pour être la première région viticole au monde, avec ses 300000 ha de vignoble. La vigne y est effectivement présente où que l’on s’y rende. Cet élément fait partie intégrante du paysage, dont la définition la plus basique, héritière d’une certaine géographie descriptive peut être : « partie de l’espace s’offrant à la vue ». Mais ce paysage est souvent le témoin d’une anthropisation. Il est façonné des milliers d’années durant par l’homme à travers de ses usages.
Et c’est bien le cas pour cette région, directement héritière d’une tradition viticole vieille de plusieurs millénaires (première région française touchée par l’essor de la vigne, il y a plus de 2500 ans). Après une longue période de production de masse, et face aux surplus démesurés provenant de cette zone, les acteurs de la filière tentent un virage dans la production de vin. On entend alors parler de « vins de terroirs ». En plus des vins de pays et vins de pays de zone marquant l’attachement du vin à une certaine zone géographique, on crée l’AOC (appellation d’origine contrôlée). Cette appellation a maintenant 20 ans dans une des régions du Languedoc : le Minervois. Ce sigle renforce l’idée de lien à la terre, une terre qui associée à certaines pratiques, donne un vin qualifié de terroir.
Mais malgré cette recherche d’authenticité, la filière viticole souffre encore aujourd’hui. Cela en raison d’une production qui reste toujours trop importante pour la demande qui est, de plus, concurrencée par des vins d’exportation (concurrence qui fait rage aussi bien à l’étranger que sur le territoire national). Les vins du Languedoc sont donc en quête de changement et certainement d’une meilleure image. C’est dans ce contexte bien spécifique qu’il a semblé intéressant, et ce dans une optique de recherche d’authenticité, de se pencher sur les relations qu’entretiennent les principaux acteurs de la filière, les viticulteurs et vignerons, avec leurs terres. Comment ces véritables jardiniers de l’espace agissent sur leur environnement ? Quelles sont les caractéristiques de ces zones que l’on appelle des terroirs ? Autrement dit, quelle est l’influence des facteurs environnementaux sur la culture de la vigne ? Et quelle est l’importance des facteurs humains dans ces terroirs viticoles ?
Pour tenter de répondre à ces nombreuses questions, une analyse assez précise des paysages viticoles et des usages liés à la vigne nous a semblée adaptée. L’objet de l’étude s’est donc porté sur une zone géographique restreinte : la commune. Cela pour des raisons d’échelle évidentes (précision des travaux cartographiques) et de disponibilité des informations (données souvent référencées par communes et centralisées par les mairies). Le choix s’est porté sur une commune du Minervois, La Caunette, située dans l’Hérault, à mi-chemin entre Béziers et Carcassonne, sur le flanc sud de la Montagne noire. L’économie de cette commune est essentiellement tournée vers la viticulture et son territoire faiblement peuplé.
La démarche de ce travail suit un découpage par grandes phases, plutôt classiques. Tout d’abord, le recueil de données variées, puis leur intégration dans un premier outil d’analyse. Ce dernier sera par la suite renforcé par l’utilisation d’un second outil, servant lui-même à une nouvelle phase de récupération de données. Vient enfin le temps de l’analyse de ces données et de leurs expressions.
Les outils employés sont de deux nature : l’un assez scientifique, est ce que l’on peut appeler un SIG (système d’information géographique) associant des informations visuelles (cartes, photos) à des informations issues d’une basse de données. L’autre, essentiellement propre aux sciences humaines, est un questionnaire dit semi directif, ayant pour but d’obtenir des informations sur le savoir-faire des viticulteurs ainsi que des renseignements sur la nature de leur exploitation.
Nous nous tournerons vers trois grandes phases lors de notre développement ;
Nous nous attacherons en premier à étayer la problématique de notre étude a travers l’analyse de la zone d’étude choisie, décrivant par là sa morphologie, ses caractéristiques climatiques, géologiques, édaphiques et biologiques. Une fois le sujet d’étude bien cerné, nous nous pencherons sur le phénomène observé : la viticulture. A travers elle seront abordés ses dimensions historiques et ses tendances actuelles, afin d’en saisir les mécanismes, mais également les enjeux qui la caractérisent aujourd’hui.
L’étape suivante consistera à décrire avec le plus de précisions possible la mise en place des outils précédemment évoqués, en nous arrêtant sur les intérêts qu’ils présentent au sein de notre démarche.
Pour finir, nous procéderons au traitement puis à l’analyse des informations obtenues grâce aux deux outils de recherche. Cela afin de vérifier l’existence et la pertinence de ce que l’on qualifie de terroir au travers d’une division de celui-ci, l’unité de terroir.
I. PROBLEMATIQUE |
Nous nous efforcerons ici de décrire les principales caractéristiques de la commune, à travers les domaines les plus variés possible : la géographie (situation), la géomorphologie, la climatologie, l’histoire, l’économie ou encore l’agriculture. Nous développerons ainsi quelques aspects de la viticulture française, mais aussi régionale et plus précisément communale. Nous nous arrêterons donc sur les grandes étapes et les événements historiques qui ont façonnés la viticulture d’aujourd’hui. Nous tenterons, à travers cela de caractériser et d’expliquer la situation de la filière viticole telle qu’est aujourd’hui.
Mais avant toute chose, il convient de s’arrêter brièvement sur certains termes ou concepts que nous allons employer à maintes reprises tout au long de ce travail.
Un des premiers mots qui vient à l’esprit lorsque l’on étudie un territoire en géographie, c’est certainement le mot échelle. Cette notion est omniprésente dans cette discipline, il est donc normal d’y consacrer quelques lignes. Il s’agit ici d’éclaircir l’emploi de cette notion, afin qu’aucune erreur d’interprétation ne soit commise lors de la lecture du présent mémoire. L’usage courant veut aujourd’hui que la taille de l’échelle soit proportionnelle à celle du territoire en question, autrement dit, grande échelle signifie vaste territoire. Or, la réalité est tout autre, l’échelle étant une fraction, elle est inversement proportionnelle au territoire auquel elle s’applique. Donc ; grande échelle signifie petite portion d’espace, et petite échelle, vaste étendue. Cela peut paraître évident pour un géographe ou pour qui à l’habitude d’utiliser des cartes, mais ce n’est évidement pas le cas de tout le monde. C’est la raison pour laquelle ce point doit être éclairci. Il est important d’utiliser ici ce terme au plus prés de sa signification réelle, employée en géographie. Une carte au format A4 au 1/25000 couvrira donc un territoire beaucoup plus restreint qu’une carte sur le même support mais au 1/100000.
Il est ensuite un concept autour duquel notre analyse va s’articuler. Lui aussi paraît être essentiel lorsque l’on s’intéresse à la viticulture. Il s’agit de la notion de terroir. L’objet de notre analyse ne sera pas de construire une définition pour ce terme, mais s’appuiera sur celui-ci, voire, en cherchera les limites. La définition choisie pour ce mot est celle trouvée sur Internet, sur un site dédié à la vigne et au vin (www.vitis.org), comme l’on en trouve beaucoup sur la toile. Un lexique y est disponible, il définit le terroir comme, pour un territoire donné, l’« ensemble des facteurs naturels (climat, sol, sous-sol, hydrologie, ...) et humains (usages et savoir-faire) qui président à la culture de la vigne et à l'élaboration du vin ». Il s’agit donc du croisement des compétences de l’homme et d’un territoire donné, caractérisé par certaines conditions, qui donnent naissance à un produit spécifique, dit « de terroir ».
I-1 : Le sujet d’étude : La Caunette |
I-1.1 : Localisation
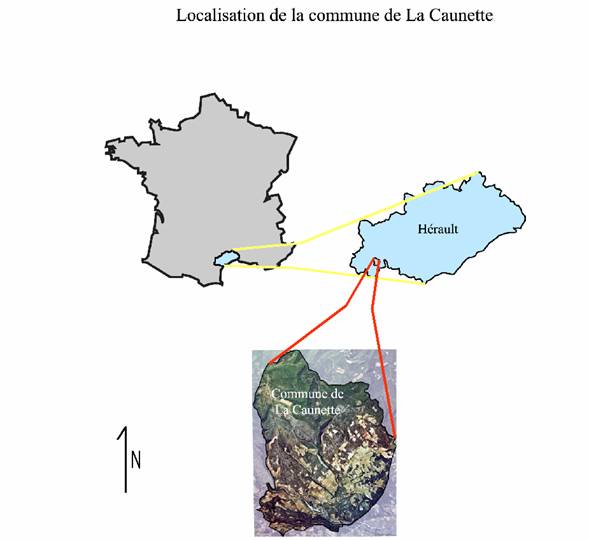
Fig.1-I Source : Photo aérienne. Réalisation : Jim Ronez.2005
La commune de La Caunette est située dans le partie sud-ouest du département de l’Hérault, à quelques kilomètres de la frontière de l’autre département de l’aire Minervois : l’Aude.
Elle est comprise dans l’aire d’influence du climat méditerranéen. Il y fait donc un temps doux et sec toutefois venté une grande partie de l’année.
Le village est distant de Narbonne d’une trentaine de kilomètres, de Carcassonne d’une soixantaine de kilomètres et d’une vingtaine de kilomètres de Saint-Pons, ville à laquelle il était rattaché au XIVème siècle.
Mais le site le plus remarquable aux alentours du village est sans aucun doute celui du village fortifié de Minerve, qui a donné son nom à cette région viticole (nom donnée par la Xème légion romaine en référence à la déesse Minerva). Cette ancienne cité a servi de place forte et de dernier bastion aux cathares au XIIIème siècle (sous Guillaume de Minerve) pour finalement tomber en 1210 sous le siège de Simon de Montfort.
Le territoire de la commune est placé au bas du versant sud de la Montagne Noire, dont le point le plus haut (le Pic de Nore) culmine à 1211mètres. Il s’agit d’un massif hercynien dont la naissance remonte à l’ère primaire, et qui est contemporain du Massif Central. Il a subi une seconde période d’élévation, lors du soulèvement pyrénéen, au quaternaire. Le territoire de cette commune s’étend sur quelques 2178ha.
I-1.2 : Un territoire aux multiples facettes |
1.2.a : Paysages et géomorphologie
La morphologie de ce territoire est très variée, lorsqu’on le parcourt par le biais d’un des trois ruisseaux, celui de Tréménal, qui le traverse selon un axe nord-sud, on se rend compte de cette diversité. Plusieurs types de paysages sont successivement traversés.
Le premier paysage remarquable est un ensemble de collines schisteuses s’élevant à plus de quatre cents mètres d’altitude et occupant près du tiers de la superficie communale. L’emprise directe de l’homme y est peu visible mis à part quelques zones de pâtures et de prairies de fauche. Le couvert végétal dominant est constitué de chênes vert, voire de chênes pubescent sur les secteurs les plus au nord. Là, le ruisseau chemine tranquillement aux pieds de ces collines.
Un nouveau paysage s’offre rapidement à la vue, de profondes et étroites gorges taillées par le cours d’eau au travers d’une épaisse couche de roche calcaire. Le paysage qui surplombe ces saillies est un causse caractérisé par un relief en pente régulière et douce. Les rares reliquats de forêts de chênes verts que l’on y trouve laissant la part belle à la garrigue à chêne kermès. L’empreinte humaine y est ici plus directement visible, l’agriculteur utilise les sols pour en faire des prairies de fauches et de pâtures, ou bien il y cultive de la vigne.
Le Tréménal quitte ensuite progressivement ces gorges en longeant puis en parcourant un paysage de mourels, constitué de mamelons de grès (où s'accrochent pins d'Alep, pins parasol et cyprès), entourés de dépressions de marnes et marnes gréseuses. Les aptitudes agricoles de ces sols marneux sont bien exploitées par les hommes et presque exclusivement à l’aide la vigne. Les reliefs de grès sont nettement moins utilisés mais quelques parcelles de vignes ainsi que des oliveraies sont néanmoins visibles.
La confluence du ruisseau et de la Cesse marque une rupture de paysages. Elle a lieu en aval d’une vallée dissymétrique (formée par la Cesse) caractérisée par une rive gauche abrupte. Elle est constituée d’une falaise calcaire contre laquelle s’étire le village de La Caunette. La rive droite est structurée en terrasses alluviales qui précédent un versant d’un seul tenant de marnes gréseuses (encore marqué par d’anciennes terrasses de cultures), surplombé par une nouvelle étendue de causse calcaire qui est cultivée de vignes.
Le cheminement parcouru par le ruisseau Tréménal se répète parallèlement, sur la limite occidentale de la commune. Là y chemine le Coupiat, qui pourfend le causse de gorges encore plus marquées que celles du Tréménal. La frontière nord-est est calquée sur le lit de la Cessière, ruisseau qu traverse un paysage de collines schisteuses puis le Causse calcaire grâce à des gorges beaucoup moins marquées, il quitte ensuite la limite administrative pour rejoindre la Cesse plus en aval. Ces trois ruisseaux sont caractérisés par un écoulement irrégulier, et généralement inexistant pendant la période estivale.
Le Cesse elle aussi souffre du déficit pluviométrique durant l’été, mais son cours n’en est pas pour le moins stoppé, il continue à s’effectuer de manière souterraine, sur toute la traversé de la commune (d’ouest en est) pour refaire surface plus en aval. La rivière poursuit alors sa course au sein d’une vallée fluviale, qui s’ouvre progressivement après quelques méandres pour finalement la terminer dans sa confluence avec l’Aude, fleuve qui se jette dans la Méditerranée en faisant office de frontière avec l’Hérault, aux Cabanes de Fleury (petit village situé sur la commune de Fleury-d’Aude).
Le reste du réseau hydrographique de la commune est limité aux proches alentours des trois cours d’eau secondaires précédemment cités.
1.2.b : Géopédologie
Le caractère temporaire des cours d’eau cheminant sur le territoire communal nous donne une idée des limites des capacités de rétention hydrique des sols.
Ceux que l’on retrouve sur la commune ne disposent d’emblée que d’une réserve très limitée, grâce aux différentes analyses réalisées par l’association climatologique de l’Hérault (ACH) en 2002 et 2003, nous pouvons en savoir plus sur ceux-ci.
Nous pouvons caractériser les principaux sols présents sur le territoire communal : ils sont directement liés au support sur lequel ils reposent, leur substrat, qui conditionne leur composition car les éléments constitutifs sont issus d’une part de la dégradation de la roche mère et d’autre part de celle de la matière organique.
Du nord au sud, on trouve ; d’abord des sols développés sur des schistes, dit sol brun acide, puis des sols développés sur des calcaires durs, dit rendzine, il s’agit là d’un sol rouge fersiallitique.
Plus au sud, un sol développé sur calcaires marins ou lacustres (tendres), il est appelé rendzine brunifiée à sol brun calcaire caillouteux.
Ces deux derniers sols sont séparés par une étroite bande constituée d’un sol brun calcaire issu de marnes laguno-marines.
Pour finir, il y a des sols développés sur alternance de grés et de marnes gréseuses, dit sols bruns calcaires.
On peut également trouver deux zones présentant des sols issus d’éboulis et « grésettes ». Il s’agit de sol fersiallitique sur les glacis et colluvial calcaire caillouteux sur les tabliers d’éboulis.
I-1.3 : La sécheresse: élément déterminant |
1.3.a : Caractéristiques climatiques
Les faibles propriétés hydriques des sols ne sont bien entendu pas les seules raisons d’un écoulement temporaire des cours d’eau, la composante climatique est essentielle dans le régime d’un cours d’eau. Et le climat qui baigne cette région est particulièrement sec, et conditionne bon nombre d’activités. Il est dit méditerranéen strict, caractérisé par une semi aridité dans la partie sud de la commune. Ce climat ne tolère qu’un très faible volume de précipitation, se situant en moyenne autour de 600mm par an, la partie nord étant la plus arrosée (autour de 700mm).
Cette augmentation des précipitations est lisible selon un gradient sud/nord et est fonction de l’altitude. Le phénomène d’ascension orographique apparaissant ici, sur le versant sud de la Montagne Noire, explique cette augmentation des pluies.
Sur l’année, il est intéressant de savoir comment sont réparties ces précipitations. Nous découperons ici l’année en fonction du cycle annuel de la vigne, comme l’a suggéré l’ACH, lors de la réalisation du document sur le terroir et l’environnement naturel de la partie héraultaise du Minervois. Il est effectivement important, dans un milieu autant conditionné par les précipitations, et d’autant plus lorsque l’on cherche à étudier un élément végétal du paysage, d’orienter son analyse en fonction de cette ressource.
Nous adopterons donc trois périodes : d’abord de septembre à mars, sept mois durant lesquels la réserve des sols en eau se reconstitue, ce qui permettra ensuite d’alimenter le couvert végétal durant la période estivale.
La période suivante correspond au cycle de la vigne, du débourrement aux vendanges, elle débute en avril et s’achève en septembre, ce sont les mois durant lesquels la vigne est la plus active.
Il conviendra pour finir de s’intéresser à une dernière période, celle de l’été, qui comprend les mois de juin à août, et pendant laquelle le volume de précipitation complémente les apports que la vigne puise dans le sol, diminuant ainsi le stress hydrique de la plante.
Durant la première période citée, le sol s’enrichit de quelques 400mm d’eau, restent donc 200mm pour la période végétative, dont 100mm tombent entre juin et août.
La saison dite sèche, caractérisée par les mois durant lesquels la moyenne des précipitations est inférieure à deux fois la moyenne des températures, s’étire sur plus de soixante jours, entre juin et août. Cela rend cette zone hospitalière pour les végétations adaptées aux climats secs.
Ce climat est dit méditerranéen strict, même s’il est moins sec dans le nord de la zone. Il se caractérise par un maximum pluviométrique en octobre et des pluies plus modérées en hiver et au printemps.
En ce qui concerne les températures, elles sont plutôt douces sur la zone étudiée, voire chaudes. Les gelées sont assez rares l’hiver dans le sud de la commune et peu fréquentes dans la partie nord, elles peuvent néanmoins atteindre une dizaine de degrés en dessous de zéro. L’été par contre, les températures sont élevées, souvent autour de 30 degrés et peuvent même atteindre 40 degrés (enregistrés en juillet 1982 à La Livinière, à quelques kilomètres de La Caunette).
Les moyennes calculées par l’ACH nous donnent une moyenne annuelle d’un peu plus de 14 degrés, d’une moyenne des minima de prés de 9.5 degrés et d’une moyenne maxima de 19 degrés (les minima et maxima étant les moyennes des températures les plus faibles d’une part, et les plus élevées d’autre part). Ces moyennes concernent le territoire en totalité, mais bien sûr, à plus grande échelle, si l’on se penche sur une particularité topographique, les données dévieront à coup sûr de la moyenne.
L’ensoleillement étant un facteur primordial dans la croissance de la vigne, et ces cultures étant situées sur des formes de reliefs assez diverses, il apparaît alors intéressant, et même nécessaire de trouver un moyen d’étudier plus précisément, à une grande échelle les variations d’ensoleillement en fonction de la topographie. Pour cela, nous pouvons consulter la carte des bilans radiatifs de la commune (cf. II-3.1).
Cette carte, inspirée d’une carte présente au syndicat du cru Minervois, à Siran, nous offre une résolution suffisante (50m de côté par pixel) pour pouvoir travailler correctement sur le territoire en question. Elle représente le bilan radiatif sur la commune, exprimé en quantité d’énergie reçu par le sol et par jour sur la période choisie (sur une moyenne d’avril à septembre). L’unité est le Kj/m²/jour. Nous aborderons plus loin la méthode qui a permis l’élaboration de ce document.
Comme nous l’avons vu, l’influence des températures est essentielle dans le cycle végétatif de la vigne, l’énergie solaire conditionne le développement de la plante, et entre en jeu dans le phénomène d’évapotranspiration (processus d’évaporation à l’échelle des feuilles de la plante). Mais un autre facteur intervient dans ce phénomène, qui permet de le ralentir, ou au contraire, de l’amplifier : le vent. Intéressons-nous à présent à cette composante du climat.
Les vents parcourant la zone proviennent principalement de deux directions opposées : il y a celui venant de l’ouest (ou Nord-ouest), qu’on appelle la Tramontane, soufflant à des vitesses assez importantes, en général supérieures à 8m/s. Il souffle souvent plusieurs jours d’affilé (on dit que le nombre de jours est multiple de trois), en hiver, il est très froid et sec. Il est engendré par un phénomène de hautes pressions continentales. C’est celui qui assèche le plus les vignes, phénomène toutefois nécessaire au processus de maturité, ou muraison du raisin.
Les autres vents que l’on peut ressentir ici sont ceux provenant de l’est ou du sud-est, venants de la mer. Ceux-là sont moins fréquents et apportent une forte humidité ainsi que de temps en temps, des pluies abondantes et durables.
La végétation est essentiellement constituée de garrigues (chêne kermès) et de forêts de chêne vert, voir de chêne pubescent, toujours pour la partie nord du territoire. Il s’agit là du milieu fortement empreint de la marque de l’homme, la garrigue étant une végétation de recolonisation. Elle occupe un espace, autrefois couvert de forêts, défrichées à partir du néolithique dont les sols furent pâturés voire cultivés par la suite. Il s’agit donc d’une végétation dégradée, établie sur un sol souvent squelettique, presque inexistant (lithosol). Les plus proches témoins d’une activité agropastorale passée sont certainement les friches. Celles-ci apparaissent quelques années après l’abandon d’une parcelle pâturée ou cultivée, ou même lorsque la pression pastorale diminue significativement. Sur la zone d’étude, ces zones-là se retrouvent à peu près partout où la vigne ne peut être cultivée, et principalement sur le versant nord situé sur la rive droite de la Cesse. On trouve également d’anciennes parcelles de vignes abandonnées qui sont parfois gagnées par la friche.
A propos de la zone de garigue proprement dite, elle occupe la presque totalité de l’étendue de la commune hors cultures, et est située dans la partie centrale, décalée vers le nord-ouest, sur le causse calcaire.
Le territoire communal s’étend sur 2178 ha. En ce qui concerne les cultures, La surface agricole utile (SAU) est, d’après le recensement agricole de 2000, de 737 hectares répartis sur 31 exploitations. 373 ha sont utilisés comme superficie fourragère et cela, principalement dans les parties nord et nord-ouest du territoire communal.
A propos des types de cultures, c’est la vigne qui est majoritaire avec près de 350 ha. On trouve ensuite ça et là des parcelles dédiées aux arbres fruitiers (oliviers, amandiers, pêchers, cerisiers, orangers…etc.).
Il y a également bon nombre de fruitiers d’agréments, le long des routes, près des maisons, dans les hameaux, les villages ou bien souvent en bordure et au cœur des vignes (amandiers, pêchers, figuiers, cerisiers).
L’olivier lui, bien que moins représenté au nord, se retrouve à peu prés partout sur la commune. Il est aujourd’hui surtout présent sous sa forme sauvage : l’oléastre. Mais autrefois cultivé très largement dans la région et, plus généralement dans le sud de la France qui comptait en 1840 26 millions d’arbres répartis sur près de 160 000ha contre 3.4 millions en 1995 (dont 720 000 pour la région Languedoc-roussillon). Ces cultures périclitent donc rapidement et comme l’écrit J.C Boyer sur le site ‘‘www.occitania.fr’’ : ‘‘Curieusement - mais tout dans cette affaire est parfaitement logique - les premiers déboires de l'olivier vont naître de la crise vinicole liée à l'apparition du phylloxéra, dés 1865.. Les conséquences de cette catastrophe seront particulièrement nocives dans notre région, même si la plupart des développements qui vont suivre s'appliquent à l'ensemble des départements oléicoles continentaux..
En effet, les vignes malades furent arrachées et de nouvelles vignes plantées sur des bonnes terres, qui, alors, étaient utilisées par l'olivier, qui se trouva ainsi sacrifié sur l'autel de la vigne…’’
Cela explique le faible nombre d’oliveraie ou plutôt d’olivettes sur la commune.
La Caunette s’est également fait connaître par la culture maraîchère, les potagers y sont très nombreux et certains y cultivent des variétés de légumes ou d’agrumes anciennes et originales (journal télévisé régional de France 3 en juillet 2002).
I-1.4 : Le volet patrimonial |
Le bâti :
Nous distinguerons ici deux types de bâti, premièrement les maisons d’habitation, ensuite les abris temporaires ou aménagements à fonction agricole.
En ce qui concerne les maisons d’habitation, le bâti des garrigues et des causses est caractérisé par un bâtiment en hauteur, au rez-de-chaussée généralement voûté (par manque de bois de charpente) et comportant l’espace réservé aux animaux et une salle commune ; à l’étage se trouvent les chambres. Les fenêtres s’ouvrent sur une cour fermée. Bien souvent un escalier extérieur donne sur une terrasse couverte. Avec l’essor viticole, les espaces traditionnellement consacrés aux animaux se convertissent en caves.
A propos des aménagements à fonction agricole, le territoire communal est parsemé de capitelles. Leur origine est sans doute très ancienne, mais la permanence de leurs éléments architecturaux en rend la datation difficile. Ce bâti se caractérise principalement par une construction en pierre sèche réalisée selon la technique de la voûte en encorbellement. Les formes sont variées (circulaire, carrées, triangulaires). Leur utilisation, elle, a évolué en fonction des besoins ; habitat temporaire pour les bergers en transhumance (alors souvent complété par un enclos également fait de pierre sèche), entrepôt à olives ou à raisin et aujourd’hui parfois cabane à outils. Elles sont traditionnellement bâties avec les matériaux résultant de l’épierrement des terrains voués notamment à la culture de la vigne.
Ces capitelles sont un élément important de l’identité paysagère du Minervois.
Les murets de terrasses agricoles en pierre sèche constituent également un élément emblématique de ces paysages. Mais, contrairement aux capitelles, il ne reste de nos jours que peu de traces de ces murets.
Notons pour finir, qu’il existait un moulin à eau au lieu dit la Cantarane alimenté par la Cesse grâce à un béal de dérivation. Moulin qui ne devait fonctionner que périodiquement vu le régime de la Cesse durant les mois d’été. Cet élément est également un important indicateur du passé de la région, de très nombreux moulins (aussi bien à eau qu’à vent) étaient bâtit dans le Minervois, permettant aux habitants de transformer leurs récoltes, principalement de blé ou autres céréales pour les moulins à vent et d’olive pour ceux à eau (la régularité étant nécessaire pour la transformation d’olives en huile).
Un autre type d’habitat, bien que très ancien, convient d’être ajouté à cette liste ; il s’agit de l’habitat troglodyte. Le village de La Caunette, idéalement construit contre une falaise calcaire, en garde des traces. De nombreuses maison sont ‘‘encastrées dans la falaise’’ elles comportent plusieurs grottes ou abris sous roches au pied des rochers qui surplombent le village. Certains abriteraient des vestiges d’habitats de l’époque préhistorique. Citons également la grotte du Sanglier, située près du passage à gué, près de l’entrée sud du village. Sur la reste de la Commune, il existe d’autre grottes préhistoriques : celle de Vialanove, sur la rivière la Cessière, ainsi que près de la Garrigue, aux lieux-dits Rassoudens, le chemin de Minerve.
La nature calcaire de la roche a donné à l’eau de ruissellement un terrain idéal pour la création de cavités durant plusieurs milliers d’années, donnant naissance à des abris parfaitement adaptés à l’homme à l’époque préhistorique.
Un dernier ouvrage humain témoigne de sa présence il y a plusieurs milliers d’années (4 ou 5000 ans BP), un dolmen. Celui-ci se situe au sud-est de La Garrigue, près du ruisseau de la combe, ce mégalithe (qui avait un usage sépulcral) possède un tumulus de 12 mètres de diamètre qui en fait un ouvrage bien visible depuis la route.
Les mines :
L’économie de la commune est essentiellement tournée vers la viticulture, il faut néanmoins noter le poids non négligeable des autres cultures qui s’y trouvent (voir plus haut). Mais il fut une époque, d’ailleurs assez proche, ou un des secteurs les plus importants était représenté par les activités minières.
En effet, ce territoire englobe de nombreuses mines de lignite, aujourd’hui désaffectées, mais qui, durant près de trois cents ans ont permis aux habitants des alentours de vivre (malgré une activité plutôt irrégulière). D’après J-P Ferrer ‘‘ La Caunette était le centre le plus important du grand bassin houiller du Minervois pour le traitement du minerai’’. De nombreux témoins de cette époque sont encore visibles aujourd’hui, la grande cheminée de La Caunette, par exemple, supportait un réservoir d’eau servant à l’alimentation de l’usine de transformation des lignites. A Babio, à l’est de La Caunette, l’ancien chevalet d’extraction est toujours visible. Un peu partout se trouvent des vestiges de cette activité passée, des chemins miniers, des entrées d’anciennes mines. Il existe des traces écrites de la présence des mines sur la commune dès le XVIIème siècle. Leur création est née d’une grande pénurie de bois dans le Languedoc dans la première moitié de ce siècle (car les verreries en étaient de grande consommatrices), l’alternative vînt donc de l’utilisation de la houille.
Mais la transformation de éléments extraits du sol remonte à une période bien plus reculée. Des restes de four ayant servi au traitement du fer sont situés non loin de La Caunette (gorges du Brian) et datent vraisemblablement de l’époque romaine. Un four de ce type est également répertorié au hameau de La garrigue.
I-2 : Le phénomène observé : la viticulture |
I-2.1 : Quelques chiffres
Le territoire étudié est fortement inscrit dans le Minervois. D’une part géographiquement, mais aussi pour des raisons historiques liées à sa proximité de Minerve, cité emblématique de la région du même nom. Une histoire qui, à l’image du Languedoc entier, est indissociable de la viticulture. Aujourd’hui encore, le Minervois est un nom synonyme de vin, cela grâce à l’AOC dont les produits portent le nom. Le territoire couvert par l’appellation Minervois représente 0,18 % de la superficie totale en vigne, et 0,31 % de la superficie couverte par les AOC en général.
Par rapport au Minervois, le territoire de la commune de La Caunette renferme 136 ha de terres classées en AOC Minervois sur près de 350 ha dédiés a la culture de la vigne. L’AOC représente donc plus du tiers de la surface viticole du territoire communal.
Le territoire français a permis, en 2003, la production de plus de 45 millions d’hectolitres de vins correspondant a une superficie de près de 850 000 hectares répartis dans plus de la moitié des départements métropolitains.
Face à cela, l’AOC Minervois permet une production de quelques 61 000 hectolitres sur une superficie de 1700 hectares. En tenant compte de l’AOC Minervois La Livinière (500hl sur 170 ha).
Pour avoir une idée des rendements qui y sont produits, nous pouvons comparer les moyennes : 56 hl/ha pour la France entière et 36,5 hl/ha pour l’appellation Minervois.
A l’échelle de la commune de La Caunette, les chiffres sont les suivants : Pour l’année 2004, 21 072,32hl pour une superficie de 347,91 ha, donc une production de 60,5 hl/ha.
Mais il faut tempérer cela en effectuant le même calcul pour les parcelles déclarées en AOC Minervois uniquement : 5356,77 hl pour 136,42 ha soit : 39,27 hl/ha.
Les rendements de la commune de La Caunette sont donc très proches de ceux de la France entière et de l’aire Minervois.
Les rapports de production entre les différentes appellations sont les suivantes : pour un total de 21072.32 hl, 5356.77 sont déclarés en AOC Minervois, 4848.79 en Vin de Pays de l’Hérault et de zone (côtes du Brian), 5254.73 en Vins de Pays d’Oc et 5612.03 en vin de table.
Chacune de ces appellations représente près d’un quart de la production totale.
En ce qui concerne les superficies rapportés à ces mêmes appellations, nous avons, dans l’ordre précédemment énuméré, 136.24 ha, puis 68.7 ha, viennent ensuite 74.37 ha et pour finir 68.42 ha pour les vins de table. D’emblée, à la vue des ces quelques chiffres, il apparaît que, pour un volume de production égale, un vigneron devra cultiver deux fois plus de surface de vigne s’il veut obtenir un vin classé en AOC, que s’il choisit une autre appellation. Malgré cela, l’image que véhicule cette dernière ainsi que la perspective d’un prix de vente supérieur permettent aux vignerons de produire du vin AOC Minervois sur plus d’un tiers des surfaces viticoles de la commune.
En 2004, 26 vignerons et viticulteurs domiciliés sur la commune de La Caunette figurent sur la déclaration de récolte. La surface qu’ils exploitent est de 322.5 ha sur 348 au total. La taille moyenne de l’exploitation est de plus de 12 ha. Six d’entre eux exploitent plus de 20 ha et totalisent 144 ha de vignes (soit 45% de la surface déclarée par les résidents de la commune). Les 12320 hl qu’ils produisent représentent plus de 50% du volume total.
Cépages utilisés :
Une part importante des types de cépages utilisés sur le territoire de La Caunette, et plus généralement celui du Minervois, est liée à des raison historiques d’implantation soit plus récemment à des décrets d’appellations. C’est ainsi que de la Syrah s’est implantée durablement par le biais de l’AOC Minervois.
Les cépages les plus répandus sont, pour les rouges ; du Grenache noir, de la Syrah noire, du Carignan noir et du Cinsault noir. Pour les blancs ; nous avons le Grenache blanc, la Marsanne blanche, la Roussanne blanche, le Terret blanc et le Muscat petits grains blanc.
Porte-greffes associés :
Bien que rarement cités dans les décrets d’appellations, le porte-greffe est un élément primordial dans la viticulture et dans la vinification. Il est le lien entre le sol et le cépage (partie aérienne), c’est la partie souterraine, qui puise les éléments contenus dans la terre ou les roches pour les restituer à la partie aérienne. Etant donné qu’il existe un nombre significatif de porte-greffes différent, il convient de se pencher sur les spécificités de chacun d’eux. C’est pourquoi il est nécessaire de s’intéresser aussi à ces derniers.
Les porte-greffes autorisés aujourd’hui dans les pays de l’union européenne (réglementation N°3800/81 du 16 décembre 1981) sont limités à trente variétés. Une dizaine d’entre eux est utilisée couramment, et neuf sur la commune étudiée. Ces derniers sont groupables en quatre ensembles : Le Rupesrtis du Lot, Le Riparia-Berlandieri (dont le seul représentant est le SO4), les Berlandieri-Rupestris (99 Richter, 110 Richter, 140 Ruggieri et 1103 Paulsen) ainsi que les vinifera-Berlandieri (41 B et 333 EM).
Ceux-ci sont le résultat d’hybridations réalisées en fonction de certains traits d’adaptabilité souhaités. Ces caractères se basent sur un comportement racinaire, une résistance à divers parasites ou maladies, une adaptation à l’environnement édaphique ; le taux d’humidité, sa composition chimique (résistance au calcaire actif) ou sa nature (silice, calcaire, argile). Le porte-greffe permet de sauver le vignoble français, mais étant issues de familles amérindiennes, les variétés s’avèrent beaucoup plus sensibles que les cépages entiers post phylloxériques, principalement au calcaire actif dont le niveau de résistance devient alors un critère primordial dans la sélection du porte-greffe.
Les premières vignes apparues sur ce qui est le territoire français actuel datent d’avant l’époque romaine. Ce sont les grecs qui ont importé la plante au VIIème siècle avant notre ère. Elles ont été plantées en premier lieu dans le Languedoc, ce qui fait de cette région le berceau de la viticulture en France. Les traditions inhérentes à la culture de la vigne y sont donc ancrées très profondément. Les première traces de vignes datent d’il y a 2500 ans, elles sont situées dans le pays Narbonnais.
Le territoire étudié ici est donc modelé depuis plus de 2000 ans par les usages liés à la culture de la vigne. L’héritage patrimonial qui nous a été transmis sur le territoire de cette commune en est directement issu.
Rappelons qu’aujourd’hui, le vignoble français s’étend sur un peu moins de neuf cent milles hectares mais qu’au XIXème siècle, il couvrait plus de trois fois cette superficie, avec quelques 3 millions d’hectares. Cela est resté vrai jusqu’à l’introduction du phylloxéra en France qui a décimé littéralement le vignoble.
Ce parasite, s’attaquant aux racines et radicelles de la vigne, provoque petit à petit l’asphyxie du pied, qui non alimenté en eau et en éléments nutritifs dépérit rapidement.
L’origine de sa présence en France est transatlantique, en effet, ce parasite provient du continent américain sur lequel il était implanté. Mais sa présence n’affectait que peu les variétés de vignes locales, ces dernières ayant développé une résistance au parasite ces vignes subissent le phylloxera, mais leurs racines cicatrisent vite et les piqûres de l´insecte sont pour elles un désagrément anodin. Ce n’est que lorsque des vignes européennes ont été introduites sur le nouveau monde que les premiers cas de dépérissement ont été constatés. Le parasite s’est ensuite étendu au reste du monde en quelques dizaines d’années, la densification du réseau de routes maritimes aidant. En France, il a suffit de quelques années pour qu’il atteigne les quatre coins du pays.
Les premiers cas avérés de présence du parasite ont été vraisemblablement constatés dans la basse vallée du Rhône en 1863 (géographie historique des vignobles, Tome 1 : Vignobles français, CNRS, actes du colloque de Bordeaux, octobre 1977, p.161), puis le phénomène s’est étendu petit à petit dans la quasi-totalité du vignoble français en touchant l’Aude, à Ouveillan, au cours de l’été 1878.
Pour tenter d’enrayer cette catastrophe, divers traitements ont été mis au point.
Au début, on injecte divers insecticides (sulfure de carbone) dans le sol à l´aide de charrues spéciales, de seringues de grande taille en métal. Ce traitement coûteux ne peut être pratiqué que dans les grands crus, et ne fait que retarder la fatale échéance.
Le recours à l’inondation, est parfois employé, mais ce remède s’avère vite être pire que le mal. En hiver, la vigne est noyée pendant 50 jours sous 25 cm d´eau. Les oeufs d´hiver du phylloxera sont tués. Ce sont donc les zones littorales ou proches de nappes phréatiques qui sont concernées. Ce genre de terroir impropre à la production de vins de qualité, se retrouve colonisé par la vigne! En 1879, quelques 9700 ha sont irrigués dans l’Aude grâce à la proximité des canaux du Midi et de la Robine.
Les grandes régions viticoles ne peuvent pratiquer cette méthode en raison de la superficie qu’elles occupent et de leur topographie (coteaux, bas de versant, plateaux…etc.).
Les terres de sables marins étant exempts du parasite, les vignobles s’étendent sur les sols à l´ouest de Sète, ou vers la Camargue, hauts lieux propices à une viticulture de qualité. Mais ces territoires ne peuvent à eux seuls, repeupler le vignoble français. L’emploi de cette solution reste donc extrêmement minoritaire.
La création d’hybrides entre souches américaines et françaises est également tentée pour résoudre le problème. Mais si cette technique se révèle plutôt bonne pour ce qui est de la résistance au parasite en question, elle s’avère inintéressante en terme de production et de qualité de fruits.
Les variétés américaines ne produisant que de petits raisins, à goût fort, voire immangeables, les hybrides dont elles sont issues gardent une bonne part de ces propriétés, ne permettant la production que d’un vin jaune tout juste correct, ou des breuvages aux goûts foxés, parfois dangereux pour la santé en raison du taux important de méthanol.
La seule réponse efficace apportée à ce problème fut le greffage.
Le principe étant de greffer des variétés dites françaises (vitis-vinifera), donnant des raisins de qualité, sur des racines « immunisés », c'est-à-dire des racines provenant de variétés américaines.
Ce sont Gaston Bazelle et J.C. Planchon qui mettent à jour ce procédé en 1876. La replantation ne redémarre réellement que vers 1878 et dure une vingtaine d´années... Le vignoble est sauvé mais s’en trouve considérablement fragilisé.
En France aujourd’hui, seules quelques parcelles de vignes demeurent « franc de pied », essentiellement sur des sols de sables marins ou les terres inondées.
Et il est encore possible de trouver grâce aux témoignages des « anciens » quelques pieds de cépages hybrides, laissés plus ou moins à l’abandon.
Le vin a toujours été intimement lié à l’environnement duquel il est issu, les conditions particulières qui entourent la culture de la vigne se ressentent jusque dans le produit fini. On dit ainsi qu’un vin a « le goût du terroir », cette expression est quelquefois péjorative mais montre néanmoins que le goût du breuvage rappelle au goûteur le terroir de la vigne. Cela est valable pour la plupart les vins faisant référence à un territoire donné. Un bon exemple à ce propos, tiré d’un ouvrage de nouvelles de l’auteur Roald Dahl traduit en français, nous montre comment un connaisseur peut retrouver le nom et l’année d’un vin sans en voir la bouteille. On peut avoir, dans cet ouvrage, un aperçu de l’extrême richesse du vocabulaire descriptif de la boisson. Le personnage faisant référence au vin qu’il goûte le qualifie de « tendre et gracieux, presque féminin dans son arrière-goût (…), chauffant, (…) tendre, docile, pensif (…) aimable, réservé et timide » ou encore, parlant cette fois-ci d’un autre cru : « le caractère du Pauillac est bien plus impérieux. Le Pauillac, à mon avis, est un peu moelleux, le sol de ce district donne à sa vigne une petite saveur moelleuse, voire poussiéreuse » [02].
Ce mariage entre terroir et vin est connu depuis des temps très lointains, mais on ne prend vraiment conscience du terroir, en tant que système équilibré entre des facteurs environnementaux et humains, qu’à la suite de l’épidémie phylloxérique. Ou plus exactement une fois la reconstruction du vignoble avancée. La perte de qualité de la boisson étant significative, la question de la qualité des cépages choisis se pose : de celle des terres cultivées ainsi que de celle des méthodes employées. Le problème peut être posé simplement : quels sont les changements qui ont fait qu’à partir d’une situation donnée ( la France postphylloxérique), productrice de vins de grande qualité, le constat d’une forte baisse qualitative est fait ? Et que faut-il faire pour renverser la tendance ? La fierté héritée d’un patrimoine viticole multiséculaire aidant, une période d’intense réflexion s’engage alors, débouchant sur la création de l’appellation d’origine contrôlée Côtes-du-rhône et Alsace.
De multiples démarches s’engagent alors dans la voie du décryptage et de l’analyse des terroirs viticoles.
I-2.3 : Appellations, Minervois et terroir
L’identité de la commune étudiée ici est très fortement déterminée par la région, non pas administrative mais historique, dans laquelle elle se trouve : le Minervois. Les produits issus des vignes cultivées sur le territoire communal sont empreints d’une certaine appartenance à cette région, ce pays. Quels sont les moyens qui ont permis de donner aux vins élaborés sur ce territoire une identité ?
Pour répondre à cette interrogation, le décryptage des diverses appellations attribuées à ces vins sera utile.
Beaucoup de gens associent aujourd'hui le Minervois à la région de production des vins de l'appellation d'origine contrôlée du même nom.
Le Minervois actuel n'est pas une entité administrative. Il est traversé par la limite entre les départements de l'Aude et de l'Hérault et il comprend 75 communes inclues dans huit cantons dont trois dans leur totalité. Les limites de cette étendue géographique correspondent à des textes juridiques précis, participants à la naissance de l’AOC Minervois.
C’est en 1985 qu’est crée cette dernière. Elle est le fruit de la reconnaissance de terroirs propres à cette région. L’INAO (Institut National d’Appellation d’Origine), qui définit elle-même les cadres administratifs et juridiques de ces zones, prône que toute appellation d’origine est d’abord et obligatoirement liée à l’existence de terroirs.
Sur le site Internet de l’INAO (http://www.inao.gouv.fr), il est indiqué, à propos de l’AOC concernant les vins, que « Cette mention garantit un lien intime entre le produit et le terroir, c’est-à-dire une zone géographique bien circonscrite avec ses caractéristiques géologiques, agronomiques, climatiques…, des disciplines particulières que se sont imposées les hommes pour tirer le meilleur parti de celle-ci. Cette notion de terroir englobe donc des facteurs naturels et humains et signifie que le produit qui en est issu ne peut être reproduit hors de son territoire. »
L'AOC constitue la catégorie de vin la plus enviée : c'est dans cette catégorie que les plus grands vins prônent. En 1935, un décret fixe les critères de qualité de l'AOC et c'est en 1947 que l'INAO est créé et, est chargée de veiller à la protection de l'appellation ainsi qu'au respect de ses critères d'agrément. Officialisées par décret, les AOC sont soumises aux règles strictes sur: l'aire de production, les cépages autorisés à planter, la méthode de culture et de vinification, le rendement à l'hectare ainsi que le degré minimal naturel du moût. Le produit proposé à la vente est contrôlé par des analyses chimiques et une dégustation. Les facteurs essentiels, qui qualifient les AOC, sont: le terroir naturel (ensemble d'éléments qui regroupent le sol, sa nature, son exposition, son micro-climat), l'encépagement et le travail de l'homme.
Dans cette même catégorie sont discernées par ordre croissant de qualité, quatre références géographiques : la région, la sous-région, la localité et le cru.
Les cépages autorisés sont choisis en fonction de leur présence historique sur l’aire d’appellation ainsi que sur les qualités qu’ils apportent au produit fini (certain d’entre eux sont qualifiés de cépages améliorateurs tandis que d’autres sont plutôt quantitatifs). Dans le cadre de l’AOC Minervois, les cépages permis sont : pour les rouges : grenache noir, lledoner pelut noir, syrah noire et mourvèdre noir (ces derniers devant représenter au minimum 60 % de l'encépagement). Les cépages secondaires sont le carignan noir, le cinsaut noir, le pincpoul noir, le terret noir et l’aspiran noir.
Pour les vins rosés, sont utilisés les mêmes variétés que pour le rouge mais un maximum de 10% par volume des variétés de raisins qui sont autorisées pour le vin blanc est permis.
Les cépages blancs autorisés sont : le grenache blanc, le bourboulenc blanc, le maccabeu blanc, la marsanne blanche, la rousanne blanche et le vermentino blanc (variétés dites primaires). Le picpoul blanc, la clairette blanche, le terret blanc, le muscat blanc à petit grains sont des variétés secondaires et ne doivent donc pas être présentes à plus de 20 % dans le produit final (et 10% pour le Muscat petit grain blanc).
Les vins portant la mention AOC Minervois doivent contenir un pourcentage en alcool d'un minimum de 11.5% pour les rouges et de 11% pour les rosés et les blancs.
De plus, la législation oblige le producteur à utiliser un raisin d’une bonne maturité, les fruits doivent contenir un minimum en sucre de 192g/l pour les variétés rouges et de 178 g/l pour les variétés blanches.
Une limite est fixée sur le rendement maximum des vignes, elle est de cinquante hectolitres par hectare. La densité de plantation est limitée à 3000 plants par hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. Il existe aussi des contraintes sur la taille des vignes.
Toutes ces contraintes doivent apporter une garantie de qualité au consommateur qui se voit justifiée par un prix d’achat supérieur à celui des autres vins non estampillés AOC. Ces conditions sont matérialisées par des décrets, lesquels peuvent reprendre et modifier les précédents en fonction de divers critères (comme une baisse du rendement maximum pour faire face à une éventuelle surproduction).
L’appellation « Vin de Pays » est également bien représentée dans cette étendue géographique. Le vin de pays correspond à un vin de table dont la provenance géographique est indiquée sur l'étiquette. Les produits de cette catégorie peuvent être millésimés. Un décret fixe les critères qualitatifs: les vins doivent provenir de la totalité de la zone de production, les cépages plantés doivent être choisis dans la liste validée au niveau du Département, le rendement est plafonné (90 à 100 hl/ha) et une procédure d'agrément est assurée par un Comité Professionnel. Dans cette catégorie, existent, par ordre croissant de qualité: des appellations régionales (couvrant plusieurs départements), des appellations départementales et des appellations locales.
Les producteurs de la commune de La Caunette ont la possibilité de produire chacune de ces appellations. Le vin de Pays d’Oc représente la version régionale (Gard, Aude, Hérault et Pyrénées-orientales), le vin de Pays de l’Héraut fait référence au département et le vin de Pays des côtes du Brian correspond au vin de Pays de zone (appellation locale).
La mention « Vin de Pays » obéit à un cahier des charges moins strict que l’AOC (bien que le vin de Pays de zone soit très encadré), mais fait néanmoins référence à une origine géographique délimitée, également basée sur certaines caractéristiques environnementales. La mention « Vin de Table », quant à elle occulte cet aspect.
Le vin de table correspond à un produit n'ayant pas le label de contrôle qui garantit que le vin obtenu provient d'un territoire délimité, ou de cépages désignés. Aucun cépage n’est interdit pour cette catégorie. Le produit peut donc être élaboré à partir de raisins provenant de régions différentes voire d’autres pays (dans ce cas le produit fini doit le préciser).
Bien entendu, ces appellations offrent un niveau de garantie au consommateur, il peut avoir ainsi la certitude que des exigences minimales sont respectées. Mais rien n’empêche un producteur d’élaborer un vin de grande qualité, issu d’un espace bien délimité et d’une grande rigueur dans la conduite de la vigne, en dehors d’une appellation dite qualitative (comme un vin de Table). Mais généralement l’élaboration d’un vin de grande qualité nécessite un coût de production élevé qui est répercuté sur le produit final. Le producteur devra alors bénéficier d’une bonne réputation s’il veut vendre son vin malgré son prix.
Dans les appellations précédemment citées, l’appartenance géographique apparaît comme un gage de qualité pour les vins. Force est de constater que plus la superficie d’une aire d’appellation est restreinte, plus le vin qui en est issu est qualitatif. Pour bien comprendre ce phénomène, il est important de pouvoir caractériser au mieux cet espace. R. Morlat a abordé cela par une approche scientifique (« Terroirs viticoles: étude et valorisation ». Ed. Oenoplurimédia, Chaintré), au travers de laquelle il met au point le concept d’unité de terroir de base (ou UTB) qu’il définit comme la « plus petite surface de vignoble utilisable dans la pratique et dans laquelle la réponse de la vigne est reproductible à travers le vin » ou encore « la plus petite unité physique homogène (éco-géo-pédologique) que l’on peut différencier utilement ». Cette caractérisation s’appuie essentiellement sur la composition des sols et leur situation topographique.
A travers toutes les classifications qui ont été abordées, et au-delà de l’origine géographique, un élément s’avère fondamental, en liaison avec le climat, dans la notion de terroir : le sol. Les études pédologiques sont donc indispensables pour bien caractériser ces zones de production. Elles sont même un préalable nécessaire à la mise en place d’une zone AOC.
En ce qui concerne le Minervois, région, rappelons-le, dans laquelle est intégré le sujet de cette étude, dans les années 1970 à 1985, la chambre d’agriculture de l’Aude a réalisé un zonage au 1/25000 du Minervois (Jacquinet, Héritier, Astruc) ayant pour but d’aider à la délimitation de l’aire de l’appellation.
Plus tard, dans les années 1990, le laboratoire « science du sol » de l’INRA de Montpellier a réalisé une autre cartographie des sols au 1/25000 sur une zone comprise entre Villeneuve-Minervois, Caunes-Minervois, Peyriac-Minervois et la bordure Nord de l’étang asséché de Marseillette. Ce travail, d’une grande précision, regroupe les sols en trois grands types, eux-mêmes divisés en sous-types contenant chacun plusieurs variations de sols. Ceux-ci sont répertoriés en fonction de multiples critères (substrat, couleur, épaisseur, texture du sol).
Les travaux qui doivent aussi être pris en compte ici sont ceux effectués par l’ACH et publiés en 2003. Ils portent sur les seize communes de l’aire Minervois appartenant au département de l’Hérault. Les données qui sont prise en compte y sont très diverses : végétation, substrat, profondeur, texture, couleur et capacité de rétention hydrique des sols mais aussi des mesures climatiques et un bilan radiatif mesuré durant le cycle de la vigne. L’ACH a ainsi pu établir une cartographie extrêmement précise des types de terroirs disponibles sur ces communes.
Les terroirs évoqués par l’étude de l’ACH sont essentiellement déterminés par la nature des sols. Une fiche descriptive de chacun d’eux est dressée, nous donnant des informations relatives à la roche mère (son origine), aux caractéristiques agropédologiques, à la gestion du l’eau, aux conditions climatiques ainsi qu’aux usages à adopter en viticulture face à ces propriétés spécifiques.
Cette dernière étude servira en grande partie de base à notre travail. Car le but de ce mémoire n’est pas, comme cela sera abordé plus bas, de recommencer un travail sur les sols, déjà fait plusieurs fois, mais de regrouper les informations actuellement disponibles, de les hiérarchiser, de les rendre facilement consultable, exploitables et modifiables mais aussi de faire en sorte de pouvoir y ajouter par la suite de nouvelles données provenant de diverses sources (photographie aériennes, satellitaires ou relevés sur le terrain).
Comme cela a été mis en évidence, les viticulteurs et vignerons peuvent choisir leur type de production en fonction, bien entendu, des caractéristiques initiales de leur exploitation et à condition de pouvoir supporter les impératifs exigés pour l’obtention de telle ou telle appellation.
A travers cela, nous avons vu qu’un exploitant viticole désirant produire un vin classé en AOC verrait ses rendements à l’hectare baisser d’à peu près 50% par rapport à une production de vin de pays ou même de vin de table.
Ainsi, cet exploitant devra trouver dans ce changement, suffisamment de compensations pour pouvoir faire le pas. C’est là un enjeux essentiel dans la viticulture d’aujourd’hui ; est-il plus intéressant pour un exploitant viticole de se lancer dans une production jugée de qualité mais peu quantitative, ou bien dans une autre à rendements importants mais jugé peu qualitative et donc moins rémunératrice ?
A cela viennent s’ajouter des problèmes liés à l’importation massive de vins étrangers en France (dont la production est déjà trop importante pour le seul marché intérieur). Il y donc de graves problèmes de surstocks.
Malgré les mesures d’incitation à la baisse de production comme les primes à l’arrachage, les vignobles français, et particulièrement ceux du Languedoc, produisent toujours trop pour les débouchés actuels. Une percée importante dans le marché international du vin semble alors plus que nécessaire. Mais cela implique une certaine uniformisation du produit, comme nous le montre bien le film de Jonathan Nociter : « Mondovino ». Ce film offre un aperçu des conséquences de l’entrée de la filière viticole dans le système de l’économie de marché. Il dénonce une adaptation les vins à la demande des consommateurs, qui souhaitent eux de plus en plus de produits faciles à consommer, procurant un plaisir immédiat. Et l’on voit ainsi l’industrie du vin s’éloigner de plus en plus de ses racines, son sol ; le terroir. Cela au profit de grands groupes élaborant des vins à grand renfort de produits pouvant être qualifiés de substitution comme les copeaux de chêne pour un goût de tanin ou les arômes divers.
Ces transformations produisent un vin toujours plus facile à consommer, un breuvage sans âme comme le qualifient volontiers bon nombre de vignerons de La Caunette. Cette industrialisation du vin, dopée à grand renfort de publicité et dont l’image est soigneusement étudiée fait de plus en plus d’ombre aux vins languedocien et français, les concurrençant chez eux, provoquant la baisse des cours du vin, et donc induisant des baisses de revenus conséquentes chez les vignerons et viticulteurs de la région.
Bon nombre de vignerons, de tendances politiques diverses, reprochent à l’Etat de n’avoir pas su anticiper cette mondialisation du vin et la baisse annoncée des cours. Les premières conséquences ont été ressenties par les producteurs de vins classés en AOC Minervois, qui ont vu leurs produits directement concurrencés par des vins du Nouveau monde. Ces exploitations étaient les plus fragiles car dépendant entièrement du facteur qualitatif lié à de bas rendements, donc très sensibles à la moindre variation de prix. Mais le phénomène s’est étendu dans un second temps aux autres productions, touchant ainsi la presque totalité des producteurs de vins de la région. Le paradoxe tient dans le fait que les politiques viticoles ont longtemps favorisé la conversion des exploitations vers la production de vins dit de qualité, mais sans être capable d’anticiper les changements engendrés par la montée de l’économie de marché en viticulture. Bon nombre de vignerons et viticulteurs se retrouvent donc aujourd’hui dans l’impasse, et accumulent des invendus en quantité industrielle.
Cette situation entraîne un mécontentement général des viticulteurs, se traduisant par des grandes manifestations, parfois mouvementées ainsi que par des actions violentes d’extrémistes visant bâtiments ministériels, grands groupes viticoles (au travers de leurs domaines languedociens) ainsi que la grande distribution (accusée de favoriser la baisse des prix). Le CRAV (comité régional d’action viticole) en est généralement l’instigateur. Ce groupe fait parler de lui à chaque période de crise, faisant parfois pencher la balance en faveur des revendications des viticulteurs.
C’est dans ce contexte pesant que les viticulteurs de la commune tentent de trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur activité.
La clôture de ce premier volet amène un certain questionnement qui peut être résumé de la sorte : Comment ce territoire, très fortement inscrit au sein de la région qu’est le Minervois, héritière d’une tradition viticole plurimillénaire,
Ce territoire d’étude est donc fortement inscrit au sein de la région qu’est le Minervois, héritière d’un passé
II : MISE EN PLACE DES OUTILS |
Deux outils ont permis d’avancer tout au long de ce travail. Il est nécessaire d’en décrire la nature, la composition et le fonctionnement tout au long de cette étape.
II-1 : Elaboration d’un système d’information géographique |
Les processus de réalisation du modèle cartographique devant servir à l’analyse du présent travail, seront décrits ici. Cette étape comportera plusieurs points ; la description de l’angle d’analyse, puis la démonstration de l’intérêt de l’utilisation d’un tel outil pour ensuite en décrire la genèse ; nous tenterons d’en esquisser le fonctionnement Pour finir.
La géographie sera abordée ici comme une science carrefour dont un des outils fondamentaux, la cartographie, lui permet d’aller à la rencontre des sciences voisines qu’elle utilise.
Ce travail sera considéré, à l’image du carrefour, comme un point de rencontre, une synthèse des travaux, ayant trait à cette région, qui ont été accessibles.
Le but étant ici de rassembler le plus de données possibles sous la plus petite division administrative du territoire qui soit : le cadastre.
A partir de ce dernier, on pourrait avoir accès à un grand nombre de renseignements sur la géo-pédologie, la climatologie ou sur la couverture végétale. Et cela concernant une seule ou plusieurs parcelles.
L’intérêt de cet outil dans le cadre de ce mémoire réside dans la possibilité de faire interagir les couches de données entre elles. Le but recherché est la détermination de caractéristiques communes à une portion de territoire, qui associée à des comportements sociaux particulier, permettrait de définir un ou plusieurs terroirs.
Une fois mis en place, cet outil pourrait être utilisé dans une optique de gestion d’un terroir, et d’en assurer ainsi la pérennité.
1.2.a : Choix des documents
Cette étape a consisté à rassembler le plus de documents possible concernant tout type de travaux ayant été faits sur le territoire d’étude ou, à plus petite échelle, sur la zone Minervois.
Le premier document, choisi comme référent est la carte Top 25 ‘‘Somail Minervois’’ 2444 Est de l’IGN (éditée en 2002). Pour un traitement informatique en vue de l’élaboration d’un SIG, il eut été préférable d’utiliser une carte déjà sur support numérique (CD rom carto explorer ‘‘Hérault ouest’’ de l’IGN), car déjà géoréférencée. Mais d’un point de vue esthétique et vu l’ancienneté des informations contenues dans ce support, mon choix c’est finalement porté sur le support papier de la nouvelle carte TOP25. S’il nécessite un travail préparatoire plus long (numérisation, correction géométrique et géoréférencement), il apporte en revanche des données plus récentes et donc plus en phase avec la réalité (carte réalisée à partir de photos aériennes de 1995, 1998 et 1999).
Nous pouvons avoir ci-dessous un aperçu de la représentation du territoire communal disponible sur le CD carto-explorer Hérault Ouest.
Fig. 1-II. Source : CD-ROM IGN Carto-Explorer ‘‘Héroualt ouest’’
Jusqu'à l’édition de la nouvelle carte TOP25, le territoire de la commune étudiée était à cheval sur deux cartes utilisant deux types de représentations différentes ; au nord une représentation adaptée à un relief de montagne, et au sud à un relief de plaine (d’où une rupture visuelle importante).
La recherche de données cartographiques diverses a succédé à l’étape précédente. Ainsi, les cartes géologiques éditées par de BRGM couvrant la zone d’étude ont été utilisées. Puis, les photos aériennes de cette zone, réalisées à des époques différentes. Mais aussi la carte d’ensoleillement de la commune (bilan radiatif avril-septembre) obtenue à partir d’un document réalisé par l’ICH (institut climatologique de l’Hérault) accessible à la maison du Minervois située à Siran.
Les autres travaux cartographiques ayant été utiles sont contenus notamment dans le mémoire de maîtrise de N.Skora et C.Calmet, intitulé « Analyse paysagère sur le commune de La Caunette » ainsi que dans un ouvrage du syndicat du cru Minervois, réalisé par l’ACH intitulé « Environnement naturel, terroir naturel ». Ce dernier document a permis d’obtenir des renseignements très utiles sur la nature des sols du Minervois et plus précisément sur la commune étudiée.
En vue de la réalisation d’un SIG, l’intégration du cadastre paraissait essentielle. La méthode de mise en valeur de celui-ci différant quelque peu de celle utilisée pour les autres documents cartographiques, ce point sera abordé à part ci-après.
1.2.b : Préparation et travaux cartographiques
Digitalisations :
En premier lieu, les documents suivants ont été digitalisés.
La carte IGN Top25 ‘’Somail-Minervois’’, scannée à une résolution assez haute (400 dpi). Puis les trois photos aériennes (n. 0005, 0541 et 0542) de la mission IGN des 29 mai et 7 juin 1996 couvrant le territoire de la commune. Enfin, les zones des deux cartes du BRGM couvrant le territoire d’étude (St-Pons 1013 et Lézignan-Corbières 1038) ainsi que leurs légendes.
Il s’en est suivi un recadrage, un assemblage et une mise en évidence du terrain d’étude.
Pour cela, plusieurs logiciels ont été utilisés ; adobe Photoshop cs pour recadrer les documents au plus près des limites communales (carte IGN, du BRGM et photos aériennes), puis Pannavue pour recomposer la zone en un seul morceau (carte géologique et photos aériennes). Pour finir une nouvelle utilisation de photoshop cs a été nécessaire afin de mettre en évidence le tracé de la frontière communale.
En ce qui concerne la carte du bilan radiatif de l’ICH, le document original étant difficile à exploiter directement (photographie d’une carte d’un mètre de côté), le décalquage les différentes zones de radiation à l’aide de polygones a été entrepris (vectorisation). Il leur a ensuite été attribuées des valeurs correspondant au niveau de radiation solaire reçu au sol. Une fois le fichier couche terminé il a été aisé de le ‘’caler’’ sur la carte IGN après que cette dernière ait été correctement référencée, comme le décrit l’opération suivante.
Géoréférencement :
L’étape finale nécessaire à l’obtention d’une bonne base de travail est le géoréférencement et les corrections géométriques.
Ce procédé aboutit au placement des documents dans un même système de coordonnées (celui retenu ici est Lambert II étendu) dont l’unité de base est ici le mètre, permettant par la suite d’effectuer divers calculs surfaciques très aisément.
Cette opération est effectuée d’abord sur la carte TOP25.
La marche à suivre étant (une fois le système de coordonnées choisi) de relever des points remarquables sur le support papier, en notant leurs coordonnées en Lambert II étendu, maillage disponible justement sur la carte en question. Puis on sélectionne ces mêmes points sur le document scanné, on y associe les valeurs relevées, et pour finir, le logiciel intègre cet extrait de carte au nouveau référentiel automatiquement.
Le logiciel utilisé ici est ArcMap, module de Arcis 9.0. Mais la méthode est valable pour les autres logiciels de traitement cartographique.
Cette manipulation permet, du même coup, de corriger géométriquement le document sur lequel on travaille. Ce qui sert à palier aux défauts éventuels apparus lors de la numérisation et, dans le cas d’une photo aérienne, de corriger les déformations dues à l’objectif.
Une fois le document étalon obtenu, il suffit de ‘’caler’’ les autres sur le modèle. Autrement dit, les autres documents ont été calés en fonction de la carte IGN. Pour cela, il a suffit de relever des points communs au document à modifier et à la carte référence. Plus les points sont précis, plus le résultat le sera. ArcMap déforme ensuite automatiquement le document afin qu’il se superpose le mieux possible à l’extrait IGN.
Vectorisation :
A noter que pour certains documents scannés, il a fallu (une fois les corrections effectuées) résoudre certains problèmes. L’analyse des paysages viticoles de la commune nécessitait des changements d’échelles réguliers, ce territoire devait être vu globalement (à l’échelle de la commune), mais aussi précisément, à grande échelle (section ou parcelle du plan cadastral). Or, pour certains des documents disponibles, l’étude à grande échelle s’avérait presque illisible, et cela, malgré le choix d’une résolution importante lors de la numérisation. A l’échelle d’une parcelle de quelques pixels de côté, la reconnaissance de la couleur (correspondante à une nature de substrat) était impossible. Il a donc été entrepris, comme cela a été vu plus haut pour la carte du bilan radiatif, une vectorisation des zones géologiques figurant sur la carte du BRGM. Cette opération n’a pas été réalisée sur la carte IGN ou la photo aérienne car ces document n’avaient pas de valeur dans cette étude uniquement pour, dans le premier cas, l’établissement d’une référence spatiale fiable et, dans le cas de la photo, une vision générale de la commune, principalement une fois mis en relief.
Il a donc été créé autant de zones que figurait sur la carte de natures de roches différentes. Une attribution à chacune de ces zones de la nature des roches qui la composait ainsi que l’époque géologique précise de leur formation a été entreprise dans un même temps. Une base de données a donc été mise en place conjointement au document.
Superpositions et anomalies :
Il convient ici de s’arrêter sur le cas de la photo aérienne. Bien que ce document ait été corrigé à partir de la carte de l’IGN, il subsistait, après plusieurs essais, des défauts importants lors de la superposition avec la carte référence ou les autres documents. Ces défauts résultent des déformations résiduelles dues aux angles d’inclinaison lors des prises de vues et à la forme de l’objectif photographique. Sur une seule photo, ces déformations peuvent être éliminées sinon réduites à une importance anecdotique, mais lorsqu’il s’agit d’un assemblage de trois pièces, ces aberrations s’avèrent difficiles à supprimer totalement. Cet assemblage devant principalement être utilisé pour une valorisation esthétique du projet cartographique, et ne devant donc pas servir de base à un zonage sur l’occupation du sol (travail réalisable sur le cadastre), il a donc été décidé que les corrections étaient suffisantes.
Ce problème de superposition n’est malheureusement pas réservé à la photographie aérienne, il a également été constaté sur les cartes issues de celles du BRGM. Dans ce cas beaucoup moins conséquentes, les anomalies constatées sont dues au niveau de précision de ces cartes (échelle au 1/50000), à leur ancienneté (derniers relevés sur le terrain en 1958, complétés en 1980) et au fait qu’elles aient été assemblées à partir de deux cartes distinctes. Là encore, ces cartes ont été conservées car les incohérences étaient localisées à la périphérie de la commune, sur des zones non cultivées, donc non pénalisantes pour ce travail.
Le cas du cadastre :
Le mode opératoire a semblé dans ce cas suffisamment singulier pour en justifier la dissociation du thème précédent.
Grâce au travail de maîtrise de Skora et Calmet, la totalité du cadastre numérisé et divisé en une vingtaine de feuilles était disponible. Mais l’utilisation prévue du cadastre imposait la transformation de ces fichiers images en fichiers vecteur (moins volumineux, auxquels peuvent être associés facilement une base de donnée modifiable à volonté). Le nettoyage du cadastre de tout ce qui n’était pas limite de parcelle (toponymie, numéros de parcelles, routes, chemins, puits…etc) a donc été entrepris pour ensuite convertir le résultat en fichier vecteur, afin de créer automatiquement des entités (parcelles) grâce au logiciel adobe Streamline.
Mais le résultat obtenu était insatisfaisant pour plusieurs raisons ; premièrement, l’ancienneté du cadastre. Datant de 1998, le parcellaire avait déjà 7 ans et donc subi plusieurs modifications. Le degré de précision de ce travail cartographique futur pouvait difficilement intégrer ce document. De plus, pour une raison d’épaisseur de trait, toutes les parcelles n’étaient pas représentées. Dans le cas d’un trait trop fin, la vectorisation aboutissait à des parcelles à « trous », et dans le cas d’un trait trop épais, la conversion ignorait les plus petites parcelles, les rendant inexploitables.
Pour une dernière raison, l’utilisation de cette version du cadastre s’est avérée impossible.
En effet, la superposition du cadastre au fond IGN (géoréférencement et correction géométrique) n’a jamais pu donner de résultats satisfaisants et cela en raison de la qualité de l’assemblage d’origine, de son volume trop important et de l’imprécision de ses tracés.
Un autre moyen d’obtention du parcellaire de la commune a donc été recherché. La Caunette ne faisant pas, encore aujourd’hui, partie des communes possédant des données cadastrales numérisées (ce qui concerne pourtant la plupart des communes aujourd’hui), sa mairie possédait néanmoins un aperçu de ce que pourrait être son cadastre vectorisé (en fait, un produit d’appel de la société réalisatrice du produit fini). Le maillage cadastral était effectivement vectorisé, divisé en sections, mais le format et le référentiel associé très difficiles à exploiter. Le format de fichier (.DXF) n’étant réellement utilisable que sous Adobe Illustrator, la manipulation a consisté à exporter les données intéressantes de chaque section (parcelles et sous-divisons) dans un format lisible par le logiciel ArcGis d’ESRI (.dwg) pour être finalement converti en un format propre à ce dernier logiciel et donc plus facilement utilisable (.shp).
Une seconde manipulation a permis l’attribution à chaque ficher les coordonnées géographiques souhaitées (par recalage vectoriel sous geoconcept). Une fois re-importé sous arcgis, le cadastre est apparu en surimpression sur le fond IGN (en fichier couche ou shape).
Il a finalement été associé à chaque parcelle son numéro afin qu’il figure sur le cadastre et dans la base de données correspondante au fichier vecteur. Manipulation longue mais essentielle aux traitements cartographiques futurs.
Carte d’encépagement :
Une fois le maillage cadastral rendu exploitable, la réalisation de la carte des cépages et des porte-greffes a pu débuter. Toujours à l’aide d’un des modules de Arcview : ArcMap.
Une base de données papier fort conséquente était pour cela disponible. Celle-ci était divisée en de multiples éléments variant selon leurs origines (INAO ou vignerons). La procédure de réalisation de la carte a consisté à travailler sur les sections l’une après l’autre. L’ajout de trois champs à la base de donnée fut nécessaire (cépages, porte-greffe et classement). En triant en fonction des numéros de parcelles, et en procédant cépage par cépage, puis porte-greffe par porte-greffe, la conception de la carte fut certes longue, mais aisée. Il a été nécessaire de sélectionner, toujours dans la base de données, les parcelles associées à un cépage, d’y indiquer le nom de ce dernier, puis d’y associer un symbole (couleur pour un cépage, hachure pour un porte-greffe) après avoir exporté les nouvelles attribution en guise de légende. La représentation graphique se fait alors automatiquement.
La difficulté rencontrée dans ce travail résultait de l’absence d’indications sur les sous-divisions du parcellaire. Ainsi, une même parcelle (admettons AR102) peut supporter plusieurs cépages et ou porte-greffes bien qu’aucune indication de différenciation ne soit visible sur le support papier. Le numéro de la parcelle apparaît simplement plusieurs fois (AR102 Carignan et AR102 Syrah).
Cette absence de renseignement s’explique par la nature de l’information correspondant au numéro de parcelle, il s’agit d’une donnée numérique, donc ne supportant pas la présence de caractère autre qu’un chiffre (cette attribution est généralement adoptée pour simplifier l’ordonnancement du parcellaire et les traitements statistiques). Pour être plus fidèle au cadastre, a fallu considérer l’identifiant de la parcelle comme étant un texte, donc pouvant supporter chiffres et lettres.
Pour savoir quelle sous-division de la parcelle correspond à quel cépage, une seule donnée est disponible : la superficie. Et c’est là qu’un des avantages du géoréférencement apparaît. Etant donné que l’unité de la carte cadastrale est le mètre, le calcul de la surface d’une entité (parcelle) doit être possible. Pour cela, il suffit d’ajouter une extension (ou plug-in) au logiciel employé et ce calcul peut se faire automatiquement. De plus, la précision de l’outil cartographique cadastral étant importante, les chiffres obtenus sont d’une grande fiabilité. Nous avons donc, en plus du numéro de chaque parcelle ou sous-parcelle, la superficie correspondante. La représentation des cépages et porte-greffes s’en trouve donc facilitée.
Réalisation du MNT :
Une fois tous ces documents prêts à être exploités, la réalisation du modèle numérique de terrain a pu débuter.
Pour cela, plusieurs phases ont été nécessaires. Il a fallu en premier lieu, digitaliser (vectoriser) les courbes isométriques (en assignant à chacune la valeur de son altitude) de la carte top25 grâce au logiciel Mapinfo 7.5. L’utilisation de ArcMap étant dans un premier temps difficilement accessible, et l’aide disponible étant ciblé sur Mapinfo, cette opération a donc été effectuée sur cet autre logiciel. Mais le mode opératoire étant, encore une fois, similaire pour la plupart des logiciels de SIG, cette opération a pu être menée par la suite sous ArcMap.
Le fichier vectoriel obtenu a ensuite été exporté de Mapinfo vers ArcMap grâce à un utilitaire d’exportation.
A suivi à cela la génération d’un fichier MNT devant servir à la création d’un modèle en trois dimensions de la zone d’étude. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. Après de longs tâtonnements, ce travail a abouti à un fichier de type MNT de qualité satisfaisante.
La précision du premier fichier MNT étant trop faible, la recherche d’une autre méthode pour le générer s’est avérée nécessaire. Pour cela il a fallu créer un fichier TIN (fichier MNT généré par une méthode de triangulation) le plus précis possible sous Mapinfo (précision impossible à faire varier sous ArcMap) à partir duquel il a été possible de faire générer au logiciel de nouvelles courbes de niveau beaucoup plus précises (équidistance 2mètres). S’en est suivi la re-exportation du fichier vectoriel sous ArcMap pour enfin générer un fichier TIN d’une grande précision.
Cartes d’analyse spatiale :
Afin d’analyser la zone d’étude, le territoire de la commune de La Caunette, certaines fonctions disponibles sous ArcMap ont été utiles, comme le module ‘‘analyse spatiale’’.
Grâce à celui-ci, il a été possible de créer automatiquement des cartes très utiles : tout d’abord une carte d’exposition ; le fichier TIN étant orienté grâce au géoréférencement, la carte générée ainsi fait apparaître tous les versants que l’on peut trouver sur le territoire étudié. A chaque couleur correspond une orientation, que la légende reprend. Nous avons donc huit couleurs, correspondantes à huit expositions (Nord, Nord-est, Est, Sud-est….etc.).
La seconde carte a avoir été créée, est celle des pentes. En fonction des dénivelés représentés sur le fichier TIN, le logiciel génère une carte sur laquelle il met en évidence les pentes de la zone en fonction de leurs dénivelés (en pourcentage), plus la pente est forte, plus la couleur correspondante est foncée.
Regroupement des données et mise en relief :
Une fois les opérations décrites ci-dessus effectuées, un regroupement de données variées (diverses cartes, photo aériennes) a été obtenu. Celui-ci a été superposé au maillage cadastral. Le but étant de pouvoir avoir accès à un maximum de données concernant une parcelle cadastrale. Et cela, en consultant le numéro de la parcelle ou bien en la sélectionnant directement à l’aide de la souris.
Pour avoir une idée plus précise du relief, que ce soit à l’échelle de la parcelle ou à celle de la commune entière, la réalisation d’une vue en trois dimensions est apparue comme essentielle. A suivi à cela l’ouverture des documents cartographiques dans un autre module d’ArcGis : ArcScene, approprié à la réalisation de modèles en trois dimensions. Il a ensuite été indiqué, dans les paramètres des documents destinés à être mis en relief, le chemin d’accès du fichier TIN. Le logiciel s’est ensuite servi de ce dernier pour donner de l’altitude au fichier initialement plat. C’est ainsi qu’une représentation en 3D extrêmement fidèle à la réalité a été obtenue, phénomène saisissant lorsqu’il est appliqué à la photo aérienne.
De même, appliqué aux autres documents cartographiques, il apporte une vision très intéressante du terrain, et des explications évidentes à certains phénomènes naturels.
II-2 : Enquête sociologique |
Une des thématiques récurrentes de cet étude est celle du terroir. Or, comme cela est décrit plus haut, ce terroir, cette construction sociale du territoire existe uniquement à travers et grâce à l’homme. Il apparaît de ce fait primordial de faire figurer dans ce travail une dimension sociale.
Le but est ici de tempérer un outil peut-être trop scientifique par un plus « humain », donc, dimension qui n’obéit pas forcement aux lois de la physique ou à la logique binaire d’un ordinateur.
II-2.1 : Positionnement dans l’étude
Comme nous l’avons vu précédemment, la notion de terroir est une construction sociale qui ne peut exister sans une dimension humaine. Certes il y a à la base un certain territoire (en général bien délimité dans l’espace) possédant certaines caractéristiques qui lui sont propres, et qui rendent cet espace singulier, mais cela est évalué par rapport à la capacité qu’a se même territoire à produire quelque chose, cela à l’aide de l’homme qui entretient cet espace. Le territoire et les méthodes de production permettent la naissance d’un produit spécifique dit « de terroir ».
Les potentialités naturelles et les méthodes culturales sont ici intimement liées. Ces dernières permettent la mise en valeur de ces potentialités.
L’homme joue donc un rôle important, et même essentiel dans l’apparition d‘un terroir, et dans son maintien.
Voilà pourquoi il serait réducteur de vouloir étudier en détail la nature d’un terroir sans prendre en compte le facteur humain.
Il est vrai que dans l’outil cartographique précédemment décrit, une place est forcément accordée à ce facteur étant donné que l’objet d’étude est le vignoble de la commune. Des données sur les cépages, les porte-greffes y figurent donc.
De plus, le rôle de nos sociétés n’est plus à prouver dans l’apparition de végétations dites « dégradées » ou « secondaires » comme la garrigue à chêne kermès ou la forêt de chêne verts.
Mais ce sur quoi il est intéressant de se pencher est le décryptage des comportements individuels ; pour quelles raisons le vigneron choisit-il l’association de tel cépage avec tel porte-greffe pour aller sur tel sol ?
Car il apparaît évident que selon les objectifs de cet acteur, son rapport avec sa terre et ses méthodes culturales, son choix s’en trouve orienté et la qualité de sa production influencée.
Il a été choisi ici de poser quelques questions aux principaux vignerons et viticulteurs de la commune, sous forme d’entretiens de courte durée. A travers cette enquête, treize d’entre eux ont été interrogés, il s’agit de ceux exploitant une dizaine d’hectares ou plus.
L’intérêt de ces entretiens étant donc de vérifier la pertinence du modèle cartographique établi et d’en tempérer les résultats.
Ce recueil d’information a donc pour but de s’informer sur les pratiques de ces viticulteurs et vignerons qui entretiennent et façonnent ces paysages.
Mais ça n’est pas là le seul objectif. Ces entretiens ont été également essentiels à la réalisation du travail cartographique. Ils ont permis d’y faire figurer une très grande partie des cépages ainsi qu’une part des porte-greffes présents sur la commune.
Des données autres que celle fournies par l’INAO ont donc pu enrichir les cartes. Bien que régulièrement mises à jours, les données fournies par l’INAO ne sont toutefois pas suffisantes pour cette étude. Il n’y figure que les parcelles (ainsi que les cépages et leur date de plantation) déclarées en AOC Minervois dans le cadre d’un plan triennal. Les porte-greffes correspondant n’y figurent pas, pas plus que les informations en rapport avec toutes les autres parcelles plantées de vigne mais non déclarées en AOC Minervois.
Ces informations là étant très peu centralisées, le seul moyen efficace afin de les obtenir était de s’adresser directement aux personnes concernées : les viticulteurs.
Mais même dans ce cas, la collecte de données ne fut pas une chose aisée, et s’avéra incomplète. Cela en raison, soit d’une méfiance de certains d’entre eux a propos de l’utilisation de ces données, soit de l’indisponibilité de celles-ci sur le moment, soit enfin en raison de l’absence pure et simple de ces informations (compte tenu de l’âge de certaines vignes ou des changements de propriétaires).
Pour pallier l’absence de certaines de ces informations, j’ai pu me rendre sur le terrain accompagné de l’un d’entre eux, Pascal Frissant, afin d’identifier les quelques porte-greffes dont la nature n’était pas déterminé avec certitude. C’est en effet les porte-greffes qui posent le plus souvent problème dans cette quête d’information.
Voilà pourquoi la cartographie en souffre, bien qu’elle soit suffisante pour l’intégrer à cette analyse.
La réalisation d’entretiens a donc une double finalité. Cela peut paraître contradictoire de vouloir tempérer un modèle cartographique à l’aide d’un outil, qui s’avère lui-même être le complément nécessaire à la finalisation de celui-ci. Mais dans ce cas, l’outil en question apporte des données (cépage et porte-greffe) qui ne sont en fin de compte, que les résultats ou l’expression de la vision de chacun de la viticulture sur ce territoire.
Ces éléments font donc partie à la fois du paysage tel qu’il peut être perçu, composante d’une certaine géographie descriptive, mais sont également le fruit de comportements sociaux individuels, ceux des acteurs de la viticulture, inscrits dans un certain territoire (donc influencés par les composantes de celui-ci).
Ils peuvent donc être considérés, dans le cadre de ce travail, comme la liaison entre la dimension sociale actuelle et les paysages.
Le but recherché à travers ces entretiens est donc de prendre connaissance des actions et des motivations des viticulteurs et vignerons de la commune.
Pour cela, il paraît intéressant dans un premier temps, de se renseigner sur les modalités qui leur ont permis de posséder, ou du moins de gérer aujourd’hui, les terres sur lesquelles ils cultivent de la vigne. C'est-à-dire les conditions par lesquelles leur ont été transmis ces terrains. On se penchera ici également sur l’ancienneté de l’exploitation.
Il convient par la suite de se pencher sur quelques caractéristiques de production de cette exploitation. Les principaux cépages et porte-greffes utilisés, les proportions de surfaces dédiées aux diverses appellations (AOC, vins de pays, vin de table), et les volumes approximatifs qui en découlent. Il s’agit là, en quelque sorte, de se renseigner sur l’orientation et la taille de l’exploitation. Et de déterminer si celle-ci s’inscrit dans une logique de valorisation du territoire et si oui dans quelle mesure.
Cela amènera à demander des informations concernant les pratiques viticoles et les méthodes culturales. Et ce afin de savoir comment l’exploitant procède pour planter ses vignes, les entretenir et comment il gère l’élaboration du produit final : le vin. L’intérêt étant ici, comme d’ailleurs plus haut, de savoir comment se place l’exploitant par rapport au marché (en termes de qualitatif et de quantitatif).
La question des circuits de vente des produits sera enfin abordée, avec elle le niveau décisionnel occupé par le producteur dans le circuit d’élaboration et de vente du vin.
Tous ces aspects permettront de dégager des orientations sur la nature de l’exploitation étudiée, sur sa position dans le marché actuel ainsi que sur la conception que peut avoir l’acteur du vignoble de son territoire.
Ce questionnaire est en fait dit semi directif. Les entretiens se déroulaient sous forme de discussions durant lesquelles le débat était orienté de manière à obtenir les informations souhaitées. Ces débats ont également été enregistrés afin de pouvoir analyser le plus efficacement possible les informations qu’ils contenaient.
Eléments de questionnement pour les entretiens
Structure de l’exploitation
Production
|
Savoir-faire Origine Objectifs
Engagement dans la transformation
Sentiments ressentis au regard de la situation actuelle |
II-3 : Présentation du SIG |
II-3.1 : Les cartes
L’objectif est ici d’énumérer et de décrire les cartes et autres représentations d’informations spatialisées constituant la base de l’outil cartographique décrit au début de ce volet. Ce travail présente donc les composantes du SIG prêt à être utilisé. Seules y figurerons ici les représentations d’informations cartographiques (fichiers image ou vecteur). Les bases de données ne pouvant être intégrées ici en raison du volume qu’elles occupent, leurs contenus seront simplement décrits.
L’ordre choisi dans le positionnement de ces cartes est directement lié à la culture de la vigne. Un survol du terrain d’étude sera effectué dans un premier temps grâce à l’image aérienne et à la carte de l’IGN, puis seront abordés les divers éléments entrant en jeu ou influençant la viticulture, les limites administratives, la pédo-géologie, l’influence solaire, les facteurs liés à la morphologie (altitudes, exposition, pentes) pour enfin terminer brièvement sur l’encépagement (cépages et porte-greffes).
La vue aérienne du territoire de la commune étudiée donne une bonne idée de la diversité des paysages abordés au paragraphe I-1.2. La partie nord de cet espace est très verdoyante, on distingue très bien l’ensemble de collines séparées par quelques cours d’eau qui se rassemblent (le Tréménal) pour se préparer à traverser l’étendue centrale de la photo qui est occupée par le causse.
Celui-ci est divisé en deux grands blocs, le premier, rive droite des gorges centrale semble très massif et inclus entièrement dans la commune. La présence de zones de cultures en périphérie de celui-ci ainsi qu’aux abords du sillon qui le traverse est à noter (nord-ouest à sud-est). La densification du nombre de parcelles utilisées va de pair avec l’atténuation des gorges creusées par le Tréménal.
La seconde partie du causse paraît peut-être moins massive, mais elle est plus regroupée, elle forme presque un disque par le biais de sa limite ouest (jonction avec l’ensemble de collines et les gorges) dont les arrêtes rocheuses dessinent un arc de cercle. Un nombre significatif de parcelles y est visible, elles sont disposées en dehors des zones où le substrat est à nu.
La vue aérienne

La rencontre du causse avec le paysage de mourels (reconnaissable grâce aux quelques bosquets et plantations perchées sur les mamelons) est très floue. On ne peut en supposer la limite qu’a travers l’explosion de la mosaïque de parcelles cultivées (particulièrement autour du village de Vialanove).
La périphérie sud-est de la commune est marquée par une densification du couvert végétal. Il s’agit là soit de zones d’accès difficile où la garrigue peut pousser sans contraintes soit de mamelons caractéristiques de ce paysage où des essences de résineux sont entretenues par l’homme.
La rive droite de la Cesse, qui coule, nous l’avons vu, selon un axe ouest-est (grossièrement), est fractionnable en trois entités. Celle qui est située le plus proche du cours d’eau (en vis-à-vis du village) est caractérisée par une utilisation agricole intense. Il s’agit là d’une étendue plane de bas de versant.
Le versant proprement dit, de pente douce (permettant les cultures) au sud-ouest du village, est plus marqué ensuite (sud du village). Les cultures y sont rares et la friche semble dominer sur d’anciennes terrasses. Le haut de versant voit les signes de l’activité agricole reprendre.
Grâce à cette vue aérienne, les espaces impropres à l’agriculture ou abandonnés en raison de leur difficile accès sont identifiables. C’est également le cas pour ceux qui, au contraire sont utilisés au moment de la prise de vue (juin 1996). Dés lors, en sachant que la grande majorité des terrains cultivés supportent des vignes ou sont en préparation pour, certaines questions s’imposent.
Pourquoi y a t’il si peu de vignes dans la moitié nord de la commune ? Comment se fait-il que la vigne contourne, traverse et ponctue ce causse qui semble si hostile à la culture ? Ou encore qu’est-ce qui permet une telle concentration de cette même culture dans un grand quart sud-est du territoire ?
L’extrait de la carte IGN couvrant le territoire communal fournit d’autres renseignements.
Le relief y est bien visible grâce aux courbes de niveaux. Les dénivelés également, laissant apparaître les mêmes ruptures dans le paysage que la vue aérienne. Les cours d’eau sont mis en évidence ainsi que les sentiers et routes.
La carte IGN

Deux routes traversent du nord au sud les deux parties du causse calcaire se ramifiant en routes secondaires et en une multitude de chemins. Une autre route de même importance longe la Cesse en direction de Minerve en amont et d’Aigues-Vives en aval.
La toponymie fournit quelques indications, « Coste » est employé pour désigner un coteau ou une zone de dénivellation moyenne. Le mot « pech » désigne un relief de type colline, « le Causse » ou « les Garrigues » parlent d’eux-mêmes. Le « Roc Blanc » laisse supposer d’un affleurement calcaire sur une colline schisteuse probablement ce qui est appelée une butte-témoin du passé géologique.
La carte IGN est un puits de renseignements divers, un condensé d’informations sur un territoire et sa précision en fait un outil de référence.
L’assemblage parcellaire vient ensuite. La carte regroupe uniquement les limites des parcelles cadastrales de la commune. C’est l’élément primordial pour cette étude, le reste des informations graphiques figurant sur le cadastre n’a pas été pris en compte (à l’exception du référencement des parcelles). Le premier constat à la vue de cette carte est la frappante dissymétrie dans la répartition des entités cadastrales. La moitié nord-ouest de la commune est simplement ponctuée de parcelles (malgré une concentration autour des hameaux et lieux-dits), le reste de la zone semble délaissée par l’homme. L’autre moitié (sud-est) est à l’inverse saturée de parcelles. La vue de cette répartition fait penser à un front pionnier, où l’homme grignoterait petit à petit sur les terres incultes. Cette répartition s’explique principalement par la nature des sols qui est plus ou moins apte à la réception des cultures. Néanmoins la mécanisation des travaux liés à la vigne peut expliquer l’existence d’un certain nombre de parcelles sur le Causse de calcaires durs. La forme des entités est aussi intéressante. Au sud de Vialanove et dans un rayon d’un kilomètre autour de Babio, les parcelles sont très irrégulières et forment des patatoïdes alors que dans une bande nord-est sud-ouest qui s’arrête à La Caunette, celles-ci paraissent rectilignes. Ce constat est la traduction du relief et de sa capacité à accueillir le travail de l’homme.
La base de données associée à cette représentation du cadastre est composée de nombreuses informations. A chaque polygone (parcelle) sont couplées des données administratives : un code de section, de parcelle, de sous-division, mais également des informations géométriques (périmètre et superficie). Cette base de données (BD) est évolutive et recevra par la suite des renseignements propres à la viticulture (cépages, porte-greffes, appellations).
L’assemblage parcellaire

La parcelle de vigne est donc limitée par des frontières administratives dans son expansion horizontale. Voyons ce qui peut la limiter dans sa dimension verticale, il s’agit là de décrire les différents substrats géologiques que la partie souterraine de la vigne peut rencontrer. Pour cela, la carte géologique est appropriée.
Le secteur nord repose sur un substrat schisteux dont la formation remonte à l’ère primaire. Le pendage des couches qu’il contient est assez variable, compte tenu du relief varié du territoire qu’il couvre. L’origine de cette roche est sédimentaire, mais elle a subi de profondes transformations à la suite de contraintes particulières. Cette roche est dite métamorphique. Les diverses variantes qui la composent se différencient par leur composition (quartz, pélites, grès, lentilles calcaires).
Vient ensuite un substrat constitué de calcaire à alvéolines qualifié de calcaire dur. La mise en place de cette roche intervient durant l’ère tertiaire à la suite d’une augmentation brutale de la tranche marine (due à des contraintes tectoniques et eustatiques). Sa résistance à l’érosion (à l’inverse de la couche qui la suit) lui permet d’être aujourd’hui bien représentée. C’est un des éléments constitutifs du Causse.
La couche qui suit est beaucoup plus sensible à l’érosion. Elle est constituée de marnes d’origine laguno-marines. Sa formation a lieu seulement quelques milliers d’années plus tard (elle fait partie du même étage stratigraphique que la couche précédente : l’Ilerdien). Un retrait progressif de la tranche marine provoque un changement de la nature de la sédimentation. Cette transgression marine marque la fin de cette période (Ilerdien). Cette roche est particulièrement sensible à l’érosion, cela en raison des conditions dans lesquelles elle s’est constituée (tranche d’eau en baisse de niveau, donc baisse de pression entraînant une compression des sédiments peu élevée). Ce qui explique sa faible étendue aujourd’hui.
L’étape suivante de sédimentation est d’origine lacustre. Il s’agit d’une roche calcaire dite tendre, formée près de dix mille ans après la couche qu’elle recouvre (Ypresien supérieur). Elle constitue l’essentiel du Causse.
La formation qui recouvre cette dernière est celle d’Assignan, des composés tels que l’argile, les limons ou les grès la constitue. Il s’agit là de marnes et marnes gréseuses (affleurements de grès). La morphologie de cette couche est tourmentée.
La carte géologique


Toutes ces formations rocheuses (à l’exception des schistes) se retrouvent sur la rive droite de la Cesse. L’ordre d’apparition y est le même (du nord vers le sud) jusqu’à la formation d’Assignan au-delà de laquelle un nouvel épisode de calcaires de Ventenac apparaît. S’en suit un autre substrat calcaire d’origine lacustre, mais plus récent et portant le nom d’Agel.
Le reste des couches géologiques est de moindre importance en terme de superficie. Les alluvions en constituent la plus grande partie. Ils se sont accumulés au quaternaire supérieur, à la fin de l’interglaciaire Riss-Würm. Leur dépôt s’est fait grâce à la Cesse, qui a creusé petit à petit son lit dans les diverses couches géologiques pour y former une vallée. Elle a donc déposé ces alluvions sous forme de terrasses successives. Les pentes (rive droite) de cette jeune vallée ont ensuite (à la fin du Würm) occasionnées un transport de matériaux par érosion et gravité (colluvions et éboulis). Le retrait glaciaire (-10000 ans) a provoqué l’accumulation d’éboulis et de débris dans des zones restreintes de la commune. Les matériaux les plus récents sont ceux apportés par la rivière (lit du cours d’eau) et sont de formes grossières (galets, graviers) ou plus fines (limons, sables). Cette formation n’est pas cultivable du fait de la fréquence régulière d’inondations par la Cesse.
L’érosion est ici un facteur fondamental, couplée aux mouvements tectoniques, elle explique les modelés qui sont observables aujourd’hui. Outre la formation de la vallée de la Cesse, déjà évoquée, l’observation du cours du ruisseau central, le Trénénal, est édifiante. Pour cela, une mise en relief de la carte géologique est utile (cf. fig. 3-II).
Cette image est le résultat d’un traitement du module d’Arcview, ArcScene, conçu pour travailler en trois dimensions. Le fichier TIN (MNT) sert de référence au logiciel pour la création du relief appliqué à l’extrait de la carte du BRGM. Le point de vue choisi est dans le sens de l’écoulement du ruisseau (du nord vers le sud) et se situe à l’entrée de ce dernier dans le Causse.
Le sens général de l’érosion est bien visible, quatre types de roches se distinguent, elles vont des calcaires lacustres aux schistes (Flysh de Cassagnoles). Chacune d’elle a successivement subi d’importants épisodes érosifs, au point de disparaître du lit creusé par le fleuve et de laisser la place à la couche inférieure. Le substrat subsistant au premier plan est constitué de schistes, c’est le type de roche le plus ancien de la commune. Ce cours d’eau est dit cataclinal.
Pour finir, la BD de cette carte contient les informations propres à l’âge des roches (ère, système, série, étage) à leur nature et à la place qu’elles occupent (superficie).

Fig. 3-II. Représentation de la carte géologique du RBRGM en trois dimensions
Les racines de la vigne atteignent souvent le substrat, puisant parfois la plupart de leurs nutriments dans celui-ci, mais elles s’appuient généralement pour cela sur le sol. Partie comprise entre la roche mère et la surface, le sol résulte de la dégradation de ce support et de l’accumulation et de la décomposition de matières organiques.
Les sols étant étroitement liés à leurs substrats, la carte qui les représente (carte géopédologique) s’avère proche de celle qui vient d’être commentée. Certains changements ont du être faits.

Les roches schisteuses sont regroupées en un seul type de sol, brun acide. Il s’étend sur près de cinq cents hectares, soit le cinquième de la superficie communale.
Viennent alors les sols du Causse ; le sol développé sur calcaires durs (rendzine), celui sur marnes laguno-marines (brun calcaire) et celui sur calcaires tendres (rendzine brunifiée).
Au sud-est du Causse, le sol est dit brun calcaire et repose sur des marnes et marnes gréseuses.
Les sols restant sont ceux sur alluvions et colluvions (Brun calcaire), éboulis (fersalitique ou colluvial calcaire) et terrasses alluviales (rouge fersalitique).
La BD de cette carte fournit des informations sur les caractéristiques de ces sols ; nom, substrat, profondeur, réserve hydrique, acidité (pH) et étendue (superficie). Ces éléments seront abordés plus en détail dans la partie suivante, c’est pourquoi l’analyse de cette carte est rapide.
Le sol et le sous-sol forment une composante verticale dans le cycle du cep de vigne, mais l’environnement horizontal participe aussi à ce cycle. Les caractéristiques spatiales qui définissent son milieu en sont un bon exemple.
A ce titre, l’altitude est une donnée fondamentale, simplement parce qu’elle peut être un facteur limitant la viticulture.
En examinant la carte des altitudes représentée sur le fichier TIN servant de modèle numérique de terrain, plusieurs phénomènes sont constatés.
L’altitude suit un gradient sud-nord de la rive gauche de la Cesse et nord-sud depuis sa rive opposée. Cette rivière matérialise donc les points les plus bas du territoire communal. Et l’extrême nord de cette commune renferme les plus hauts points (proches de 500 mètres).
Cette carte étant une image créée à partir de courbes de niveau vectorisées, représentant ainsi les altitudes en fonction de plages de couleurs (et intégrant la valeur de l’altitude de chaque pixel directement à l’image), aucune base de données n’y est associée.
Des anomalies attirent toutefois l’attention. Les légers sillons parcourant le Causse dans le sens de la pente et accueillant des ruisseaux secondaires paraissent très torturés. Cette erreur, bien que réduite très significativement grâce au cheminement emprunté pour créer ce document (cf.II-1.2), est encore présente. Elle provient de la méthode utilisée pour créer ce MNT.
La carte des altitudes

Cette dernière (création de fichier TIN par triangulation) doit être employée pour convertir les points significatifs d’un territoire en MNT, or les courbes isométriques, à l‘inverse des sommets ou bas-fonds, ne sont pas considérées comme telles.
Pour garder l’exemple des ruisseaux du Causse, on distingue des zones plates suivies de pentes et ainsi de suite.
Le logiciel a donc mis en valeur le tracé suivi par la courbe de niveau, créant un plat au dessus, une pente en dessous, là où il devrait y avoir une pente douce et régulière, suivant le trajet du cours d’eau. Malgré cela, cette méthode (parmi celles proposées par le logiciel) est celle qui procure le meilleur résultat, grâce à la réalisation d’un couvert de lignes de niveau d’une grande densité. Les autres modelés n’en souffrent pas.
La carte des pentes, réalisée à partir du fichier TIN évoqué ci-dessus, met bien en évidence les écueils de la méthode employée. Le Causse semble parcouru de grossières courbes de niveau, mais cela n’empêche pas une lisibilité suffisante de la carte.
Les pentes les plus faibles (0 à 3°) coïncident avec la fin du Causse calcaire et s’éparpillent sur un grand quart sud-est de la carte. Elles sont aussi présentes dans son extrême sud. Le Causse est caractérisé par une pente moyenne (3 à 9°) et constante (si l’on occulte les anomalies). La zone des mourels est flanquée de pentes très variables, notamment dans sa partie sud. Une pente globalement forte (17 à 41°) marque le versant de la rive droite de la Cesse, de même que les limites ouest et nord-est du Causse ( jusqu’à 81°), ainsi que le réseau hydrographique du Tréménal (41 à 81° dans le canyon).
Ces pentes conditionnent les activités humaines, leurs imposant de lourds aménagements s’ils choisissent de mettre en valeur un terrain de forte inclinaison. Cela est vrai avec la viticulture, et accentué par l’utilisation de machines (préparation des sols, traitements ou vendanges) non adaptées à tous les dénivelés.
Cette carte étant, comme son fichier source (le MNT), un fichier image, elle n’est pas associée à une BD. Toutefois, dans l’optique d’une analyse plus précise, le chapitre III-2.1.b aborde une procédure permettant l’ajout de données à cette carte.
La carte des pentes

La carte d’exposition

Aux altitudes et aux pentes manquent les orientations pour caractériser le relief d’un territoire. Ces dernières sont fournies par la carte d’exposition. Chaque facette du relief est représentée par une couleur correspondant à une orientation.
Le territoire en question est globalement exposé au sud (entre sud-est et sud-ouest), captant ainsi un maximum de l’énergie solaire.
Les saillies observées dans le Causse sont là très bien visibles, le relief tourmenté de la zone de marnes gréseuses également. Le versant rive droite de la Cesse se démarque par son orientation inverse à la tendance, et pour finir, les vallonnements creusés par les affluents du Tréménal s’offrent à tous les points cardinaux.
Comme pour la précédente carte, aucune base de données n’est, dans un premier temps, associée à ce document.
L’orientation générale du territoire communal au sud se traduit effectivement par un ensoleillement global élevé. C’est ce que nous montre la carte du bilan radiatif journalier. Il s’agit là d’un facteur essentiel en viticulture, l’orientation de la parcelle apporte à la vigne un certain niveau d’ensoleillement qui joue un rôle primordial dans son développement, c’est une nouvelle composante verticale du cycle de la vigne. La cartographie en question est le résultat, non pas de relevés sur le terrain, mais de l’application d’un modèle théorique de rayonnement solaire (à la surface du globe) au modèle numérique de terrain de la région. La précision (taille du plus petit élément) de ce MNT n’étant que de cinquante mètres de côté, le résultat ne peut être utilisé de manière approfondie. Ce modèle théorique, mis au point par Lalit Kumar, scientifique australien spécialisé dans les systèmes d’information géographique, détermine la quantité d’énergie solaire reçue au sol en fonction du MNT géoréférencé. Ainsi l’inclinaison de la Terre par rapport au soleil est compensée.
Il en résulte la carte qui suit, les zones recevant le plus d’énergie solaire sont caractérisées par une exposition au sud et une pente moyenne (pour compenser l’inclinaison du à la latitude). A l’inverse, les versants exposés de l’ouest à l’est et au nord reçoivent moins de radiations. En fait, l’énergie reçu par un versant est inversement proportionnelle à l’angle qu’elle fait avec le sud. Les secteurs de très faible pente (quart sud-est) bénéficient d’un bilan radiatif moyen.
La BD de cette carte indique l’intervalle d’énergie reçue pour chaque couleur de polygone.
La carte du bilan radiatif journalier

L’influence de toutes les observations effectuées jusqu’alors associée à celle de la composante sociale, le viticulteur, accouche de la carte d’encépagement sur laquelle figurent les parcelles supportant de la vigne, le cépage et le porte-greffe correspondant.
A l’image de l’assemblage parcellaire, commenté plus haut, la grande majorité des entités cultivées sont dans la moitié sud-est de la commune. Mais un nombre non négligeable d’entres elles, est situé de l’autre côté, près du hameau du Cazal, sur la périphérie sud-ouest du Causse et au sud du Sieure. La vigne est également cultivée aux abords du hameau de La Garrigue.
Elle est peu représentée dans les versants comme la Coste de Babio ou les Costes (versant faisant face au village de La Caunette).
Les cépages dominants sont incontestablement les rouges (Grenache noir, Carignan noir et Syrah noire). Les porte-greffes les plus visibles sont ceux appartenant à la famille Berlandiéri-Rupestris, dont les variétés (99 Richter, 110 Richter 140 Ruggieri et 1103 Paulsen) sont adaptées aux sols calcaires ou argilo-calcaires et à la sécheresse.
La BD de ce document est celle du parcellaire à laquelle ont été ajoutées des informations, par parcelles, sur l’encépagement (nature du cépage, type de porte-greffe et classement de la parcelle).
Une fois tous ces éléments mis en place, donc superposés, l’outil cartographique est prêt à être utilisé grâce aux croisements de cartes et de données.
La carte d’encépagement


II-3.2 : Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement de cette réalisation cartographique a été rapidement abordé plus haut, il s’avère à présent nécessaire de l’approfondir.
3.2.a : Bases de données associées
Le but poursuivi ici de disposer d’un maximum d’informations caractérisant la zone étudiée et cela à l’échelle de la parcelle cadastrale.
Cela afin d’étudier les éléments rentrant en compte dans la culture de la vigne, à savoir, les facteurs comme la nature du substrat, le type de sol et sa réserve hydrique, le type de végétation ‘’naturelle’’ (c'est-à-dire en admettant que l’homme n’ait rien planté), puis ce qui tient du climat et de la topographie, comme le bilan radiatif, l’exposition, la pente mais aussi l’hydrométrie.
Et ce en fonction du vignoble présent sur la commune et à partir de l’inventaire le plus précis possible des cépages et porte-greffes qu’il soit possible d’y trouver.
Ainsi, en cliquant sur une parcelle, il est possible d’obtenir non seulement son numéro, mais également toutes les informations dont il est question plus haut, et cela, rapporté à la portion de territoire sélectionné.
Le but étant de pouvoir mettre en évidence des zones présentant des caractéristiques particulières pouvant être isolées en unités de terroir.
Le module d’ArView, ArcMap est à nouveau utilisé pour mettre en relation ces données. La technique consiste à ouvrir à l’aide de ce logiciel les cartes commentées au chapitre précédent. Ces documents étant géoréférencés, ils se superposent d’eux même. Laisser toutes ces cartes affichées ne servirait à rien, elles sont donc masquées, seules les couches représentant les cépages et les porte-greffes sur le maillage cadastral sont laissées visibles. Le but recherché ici est d’obtenir les informations souhaitées à partir d’une parcelle, l’outil « Identifier » (dans la barre d’outil un i inclus dans un disque bleu) est sélectionné. Une fenêtre apparaît alors, dans laquelle doivent êtres indiquées les couches faisant parti de la sélection : <Toutes les couches>. Il suffit alors de cliquer sur la parcelle choisie pour voir tous les renseignements qui lui sont propres s’inscrire dans la colonne de gauche de la fenêtre d’identification.
Ces attributions sont classées par couches, et directement lisibles. Dans le cas où plusieurs champs d’une même couche sont requis, la couche en question doit être sélectionnée afin que le détail de tous les champs s’inscrive dans la partie droite de cette fenêtre. Ainsi si l’on veut obtenir le numéro et la section de la parcelle, sa superficie ou son classement (appellation), on clique sur le types de porte-greffe ou de cépage (leur BD étant communes, les mêmes informations s’affichent).
La référence à la légende de la couche « expositions » (visible fig.4-II), dans la colonne de gauche) est nécessaire pour connaître l’orientation de la parcelle, car l’attribut de la couche en question est une valeur numérique (56.56), qui correspond à l’intervalle « 22.5-67.5 », l’orientation est donc nord-est.

Fig. 4-II. Extrait de la carte d’encépagement sous ArcMap.
Dans le cas de la géologie, la base de données fournit plusieurs caractères (cf. fig. 5-II).

Fig. 5-II
Pour les sols, les informations sont données ainsi :

Fig. 6-II
Les informations propres à chaque couche du projet étant stockées dans les bases de données réciproques, la possibilité de mise à jour de ces données est très intéressante, particulièrement dans l’optique où ce projet serait réutilisé à l’avenir. Effectivement, il s’agirait d’avoir la possibilité de modifier efficacement et rapidement la nature du cépage et du porte-greffe de telle ou telle parcelle, de mettre à jour le maillage cadastral si besoin, d’approfondir la composition des sols, d’intégrer des données climatiques (pluviométrie, température, humidité) ainsi que de rajouter n’importe quelle autre information jugée utile.
3.2.b : Superpositions et observations
Pour avoir d’autres critères d’analyse, la superposition d’images peut être utilisée. A titre d’exemple, si l’on cherche à établir un rapport visuel entre l’encépagement et les pentes, on peut observer la superposition de ces deux couches, comme nous le montre la figure qui suit.

Fig. 7-II
Il apparaît donc ici très instructif de pouvoir disposer d’un volume important d’informations de toute sorte ayant trait, de près ou de loin, à la viticulture, et cela en un seul coup d’œil. Nous pouvons ainsi nous informer sur des composantes géologiques, pédologiques mais également édaphiques d’une zone bien précise, de l’ordre de quelques centaines de mètres carrés.
Le complément sur CD-ROM fourni avec le présent mémoire permet d’avoir accès aux mêmes informations. Quelques différences existent entre les interfaces d’utilisation (le logiciel fourni, ArcReader sert uniquement à la lecture de cartes) et dans la fonction de mise à jour (corrections, ajout de nouveaux champs impossibles).
La simplicité d’accès à ces données paraît alléchante, mais qu’en est-il de la pertinence de cet outil ? Peut-on réellement dégager grâce à lui des ensembles homogènes aptes à donner au vin qui en est tiré des caractéristiques spécifiques ?
Pour répondre à cela, il faut procéder au croisement et à l’analyse des données fournies par nos deux outils avec le plus de précision possible.
III : INTERPRETATIONS |
Dans l’optique de l’établissement de portions de territoire pouvant être qualifiées de terroirs, ce chapitre va traiter dans un premier lieu, à l’aide des données fournies par l’outil cartographique (le SIG), des caractéristiques du vignoble à l’échelle de la commune entière, pour établir une référence. Il sera par la suite question de trouver les bases d’une division du territoire pour dégager de ce dernier des entités distinctes en s’appuyant sur les deux outils disponibles. L’étape finale consistera à rechercher les limites de cette différenciation.
III-1 : Traitements statistiques à l’échelle de la commune |
A partir des informations figurant sur le SIG de la commune, un certain nombre de calculs ont pu être effectués permettant de se forger une idée plus précise des caractéristiques viticoles de ce territoire. Ces dernières viennent confirmer les observations faites sur les documents cartographiques, mais une analyse statistique peut permettre de les affiner significativement.
III-1.1 : La domination des cépages noirs
La base de données associée au parcellaire permet de dégager quelques aspects caractérisant l’encépagement de La Caunette. Pour cela une mise en relation entre les diverses données disponibles est effectuée.
Le premier phénomène constaté est celui de la supériorité spatiale des cépages rouges, plus exactement de quatre d’entre eux, le Carignan noir qui s’étend sur plus de 80ha, suivi de la Syrah (plus de 65ha), du Grenache noir (62ha) et du Cinsaut noir représenté sur une quinzaine d’hectares. Pour mieux apprécier cette disproportion, et dans un souci de lisibilité, ces cépages ont été représentés sur un histogramme spécifique (fig.1-III).
La production de vin issu des vignes de la commune est donc essentiellement rouge. Les quatre cépages les plus représentés occupent plus de 91% de la surface et 88% du nombre de parcelles dédiées à la vigne (cf. fig.3-III). Deux de ces cépages sont considérés comme quantitatifs (d’après le décret de l’AOC Minervois) la Carignan noir et le Cinsaut noir, ils représentent 40% de la superficie totale. Il y a là des conditions qui ne se prêtent pas à une amélioration de l’image du Minervois.
Mais la culture de cépages dits améliorateurs, comme la Syrah ou le Grenache entraîne des coûts d’exploitation supérieurs. Ces variétés sont plus sensibles aux aléas climatiques et leur entretien exige plus d’attention. La Syrah illustre très bien cette fragilité, d’après les témoignages recueillis, la cultiver représente un certain investissement, elle est décrite comme un cépage peu fiable dans sa symbiose avec le porte-greffe et sensible aux vents violents (rameaux cassants). Le port du cep de Syrah impose de plus un palissage, dont le poids financier n’est pas négligeable. Un dernier point ne joue pas en sa faveur, c’est qu’elle n’est implantée dans le Minervois que depuis quelques dizaines d’années, principalement sous l’impulsion de l’AOC. Les vieilles vignes n’en sont donc pas garnies et le recours à ce cépage n’est pas forcément ancré dans les mentalités des plus anciens.
Malgré ces inconvénients, plus des trois quarts des viticulteurs interrogés se disent prêts à produire plus d’AOC, dans le cas où cette appellation serait revalorisée, cela leur permettrait d’investir sans trop prendre de risques.

Fig.1-III
Les autres cépages sont représentés par la figure qui suit. Cette fois-ci ce sont quatre cépages blanc qui dominent, en totalisant tous une superficie de 2 ha (20000m²) au moins ; le Vermentino blanc, le Grenache blanc, la Marsanne blanche et le Terret blanc.
L’encépagement total en cépages blanc représente moins de 20 ha sur les 250 figurant sur la carte cadastrale ce qui correspond à 8% de la surface plantée et moins de 10% du nombre de ces parcelles (fig. 3-III).
Cette faible représentativité peut s’expliquer par la place trop hésitante réservée aux vins blancs sur le marché, qui peuvent néanmoins être de qualité. C’est plus vrai encore à propos de l’AOC blanc dont la production reste anecdotique sur ce territoire, si bien que la fiche d’engagement triennal en AOC fournie par l’INAO de Narbonne ne mentionnait aucune parcelle de cépage blanc.

Fig.2-III
Le tableau qui suit reprend les surfaces occupées par chaque cépage, en informant du nombre de parcelles correspondant.

Fig.3-III
Le paysage viticole de La Caunette est donc dominé par les cépages rouges, plus précisément par le Carignan noir
III-1.2 : 110 Ruggieri : Porte-greffe roi
Malgré un faible volume de données collectées concernant les porte-greffes, un phénomène apparaît. Il s’agit de la sur représentation d’un porte-greffe de la famille des Berlandieri-Rupestris, le 110 Richter. Ce porte-greffe est disséminé sur toute l’étendue du vignoble de la commune. Mais ce qui étonne le plus c’est de voir (cf. fig.4-III) qu’il est associé à tous les types de cépages, à l’exception de trois (Macabeu, Merlot et Terret Blanc). Le porte-greffe ayant pour rôle d’acheminer les minéraux présents dans le sol (sève brute) en échange de nutriments organiques (sève élaborée), et possédant des caractéristiques particulières d’adaptation aux sols (cf. I-2.1), il est légitime de penser que la systématisation du recours à un même porte-greffe -pour divers cépages- nuit aux capacités d’adaptabilité d’un cep de vigne à son environnement. Ainsi, les cépages que l’on retrouve associés au 110 Richter devraient voir l’expression de leurs spécificités diminuer en raison de leurs racines similaires, donnant aux fruits de ces cépages quelques propriétés communes. Même si les effets possibles sur la partie aérienne sont minimes, ils participent à une diminution de la typicité du produit final.
Le fait que ce porte-greffe soit présent sur tous les types de sols de la commune permet de douter qu’il soit exclusivement lié à un sol. Il est de plus décrit comme étant bien adapté aux terrains argilo-calcaires, compacts et peu profonds.
Une très grande résistance à la sécheresse explique en partie sa diffusion, qui dépasse 55 % de la superficie occupée par les neuf variétés recensées sur la commune. Mais d’autres porte-greffes sont bien adaptés à ce genre de rigueur climatique. Parmi eux, et dans la même famille que le 110 Richter, il y a le 140 Ruggieri. Celui-ci est le second porte-greffe le plus utilisé.
Cépages par porte-greffes : Superficies

Fig. 4-III. Source : BD cadastre. Réalisation : Jim Ronez.2005
Sa représentation dans la figure 4-III permet d’en tirer quelques remarques, il est essentiellement greffé à un seul cépage, la Syrah, sur une quinzaine d’hectares. Syrah qui est associée à près de 60 % à ce porte-greffe (par rapport au total de la superficie en Syrah dont le porte-greffe est connu). Le cépage en question est considéré comme étant sensible à la sécheresse, le porte-greffe, lui est qualifié d’une rusticité remarquable et d’une bonne adaptation aux terres calcaires, sèches et pauvres. L’examen de ces chiffres laisse penser que cépage et porte-greffe s’associent bien ensemble mais d’après un ingénieur en oenologie interrogé, cette combinaison est très risquée, car elle peut induire une forte mortalité, et ne doit être faite qu’en dernier recours. On peut par ailleurs noter, qu’une greffe réussit apporte un regain qualitatif à la plante. Un des viticulteurs témoigne avoir pratiqué cette association en raison du trop fort taux de calcaire actif contenu dans le sol, dans un secteur du Causse particulièrement aride. La forte représentation de cette alliance semble donc s’expliquer.
La consultation du SIG permet de vérifier cette explication. Lorsque la carte d’encépagement est superposée à celle des sols, il est constaté que la petite trentaine de parcelles correspondant à cette association est répartie sur les trois types de sols les plus utilisés pour la culture de la vigne, à savoir les sols développés sur marnes laguno-marines, sur calcaires tendres et sur marnes et marnes gréseuses. Ces trois sols peuvent potentiellement montrer des taux de calcaire actif élevé.
Une interaction entre le Carignan et le Rupestris du Lot est également relevée. Ce porte-greffe montre une résistance au calcaire actif plutôt moyenne, inférieure à celles développées par les deux précédents, et une grande vigueur. S’il est associé au Carignan, c’est bien souvent sur des parcelles âgées, témoignant du passé marqué par la loi du rendement maximum.
Le porte-greffe le plus adapté, lorsqu’il s’agit de rendements maxima est sans aucun doute le SO4, il n’est donc pas étonnant de le voir associé à un Carignan. Mais il est ici couplé par deux fois avec une Syrah. C’est là encore un exemple d’association contradictoire, d’autant plus contradictoire quand ces parcelles sont déclarées en AOC.
En ce qui concerne les 333EM et 161.49 (porte-greffe des grands crus), qui sont des porte-greffes qualifiés de hautement qualitatif, il n’est pas étonnant de les voir associés à une Syrah en AOC. Mais ceux-ci sont ultra minoritaires et ne sont représentés que par une seule parcelle chacun.
Le cas du 41B est particulier, étant très résistant, qualitatif, mais sensible à la sécheresse, il est placé à proximité de la Cesse, sur une parcelle caractérisée par une pente moyenne (11°) exposée au Nord. Les conditions sont ainsi réunies pour que cette variété se développe correctement. Elle est greffée à un Grenache, le tout déclaré en AOC.
Pour finir, le 99 Richter est un porte-greffe qui peut être d’une grande vigueur, mais dont le niveau de résistance à la sécheresse le fait régresser au profit du 110 Richter. Il n’est pas reconnu pour être très qualitatif. Il est ici associé aux Carignan et Grenache.
Pour le choix d’une variété de porte-greffe, le viticulteur doit s’appuyer sur deux éléments principaux : l’optique de rendement (souvent liée à l’appellation), et les données liées à la parcelle. Le choix disponible sur le marché peut être aussi une condition importante.
Pour cela, certains font réaliser des analyses de sol (notamment pour le taux de calcaire actif) et creuser des fosses pour déterminer l’enracinement possible. D’autres se basent sur leurs connaissances, leur expérience ou sur les conseils des anciens.
Une fois ces éléments définis, l’association cépage/porte-greffe peut être choisie rapidement.
III-1.3 : L’AOC : dominante malgré tout
Lors de recherches sur les terroirs viticoles, s’intéresser aux appellations est une chose essentielle. Grâce à la base de données couplée au cadastre, caractériser ces classements par le biais de leur traduction dans ce paysage viticole est possible.
L’AOC (dans la filière viticole), comme il a été vu plus haut (cf. I-2.3), est fondée sur une notion de terroir, et sa mise en place part d’une volonté de donner une garantie de qualité de produit tout en permettant progressivement au vignoble français de retrouver une certaine renommée. Dans ce but, les décrets d’AOC fixent un cadre géographique précis ainsi qu’une série de conditions à remplir. Sur le vignoble de La Caunette, plus du tiers de la production de 2004 est classée en AOC. Les cépages et leurs porte-greffes bénéficiant de l’appellation sont représentés sur la figure 5-III. Pour une analyse plus approfondie, seules les parcelles dont le porte-greffe est connu sont prises en compte.
L’AOC à La Caunette, cépages et porte-greffes

Fig. 5-III
Parmi les cépages figurant sur cet histogramme, aucun n’échappe au greffage sur 110 Richter, porte-greffe incontournable sur la commune, sa culture représente 50 % de la superficie des porte-greffes en AOC. Bien qu’adapté aux conditions climatiques locales ainsi qu’aux sols argileux et calcaires, il n’en est pas pour autant un porte-greffe spécialement qualitatif. La place qu’il occupe dans les vignes de l’AOC paraît trop importante.
Bien que cette analyse se base sur des surfaces bien inférieures à la réalité (pour les chiffres concernant les porte-greffes), il y a fort à parier que la prolongation de ce travail permettrait d’afficher les mêmes tendances.
La cas de la Syrah, associée eu 140 Ruggieri, a été abordé dans le point précédent mais il peut être utile d’ajouter que ce greffage, même s’il est incertain, permet une production d’une grande qualité. Celle-ci alors issue d’une vigne qui permet la mise en valeur de l’environnement dans lequel elle pousse, son terroir naturel. Les autres variétés associées à ce cépage ont été décryptées précédemment. Les 161.49, 333EM et 41B sont en adéquation avec une recherche de qualité prônée pas l’AOC. La culture sur SO4, associé également au Grenache, paraît traduire une volonté de baisse des coûts de production au détriment d’une recherche de typicité. L’utilisation du 1103 Paulsen se place dans une optique de rendements moyens (pour une AOC), formant un compromis entre une appellation hautement qualitative, très coûteuse et une autre, de faible qualité, réductrice de coûts.
Ce compromis paraît également avoir été recherché au travers des couples Grenaches, Carignan et 110 Richter, mais aussi Carignan – Rupestris et 99 Richter.
Trois rapports à l’AOC sont donc appréhendés à la vue de l’histogramme. D’une part, la volonté de se servir de l’appellation comme d’une garantie commerciale, d’une assurance de bonne vente, en poussant les rendements aux limites du cadre législatif, pour tenter d’accroître les bénéfices tout en réduisant les coûts. D’autre part, un souci de recherche ambitieuse d’amélioration de la production, à l’initiative d’investissements considérables, permettant de dépasser les minima de qualités inscrits dans le cadre de cette AOC. Le dernier rapport à cette appellation est une production moyenne, soucieuse d’une inscription dans les critères fixés par les décrets, mais frileuse quant à la recherche d’un niveau de qualité supérieur.
Mais ces trois visions de l’AOC ne correspondent que rarement à trois catégories de vignerons, et bien souvent, ces rapports différents cohabitent au sein d’une même exploitation.
Une autre appellation semble être représentative de l’expression d’un rapport du vigneron au territoire, le « Vin de Pays ».

Fig. 6-III. L’appellation « Vin de Pays » à La Caunette, cépages et porte-greffes
La diversité des cépages est ici bien marquée, le premier constat est celui de la bonne représentation des cépages blancs. Cela permet de penser qu’à l’inverse de l’AOC, le vin de pays blanc à sa place sur le marché.
Les porte-greffes utilisés ici –représentés encore une fois par le 110 Richter- correspondent bien au niveau de qualité véhiculé par l’appellation, voire plaident en faveur d’une recherche de qualité (utilisation du 140 Ruggieri). Mais l’utilisation de variétés comme le SO4 permettent de s’apercevoir qu’une hiérarchie qualitative semblable à celle décrite plus haut existe aussi ici.
Les cultures liées à l’appellation « Vin de Table » ne seront pas détaillées ici, cela en raison d’une quantité d’information disponible non significative à ce sujet. Il faut simplement retenir que d’une part, les variétés les plus utilisés sont le Carignan noir et le 110 Richter, et d’autre part, que la production issue de cette appellation représente plus du quart du volume total de l’année 2004. Mais le fait que cette dénomination ne s’appuie pas sur une appartenance géographique est suffisant pour en déduire qu’elle ne prône en aucune façon une recherche de qualité. Libre alors aux vignerons de construire leur circuit commercial s’ils choisissent une production de qualité hors appellation géographique, qui garantit un certain prix de vente (en temps normal).
A propos de prix de vente, dont les minima sont sensés être garantis dans le cadre de ces appellations géographiques, la période actuelle est riche en enseignements. Il n’est pas rare de trouver aujourd’hui en grande surface des vins AOC à 2 euros la bouteille. Dans ce cas les lourds investissements supportés par les viticulteurs dans une optique qualitative ne sont en aucun cas justifiés. Plusieurs choix s’offrent alors à eux. Ils peuvent diversifier leur circuit d’écoulement, en se tournant vers l’exportation à l’étranger. Ils peuvent aussi travailler sur la communication, en réalisant des brochures ou un site Internet mettant en avant la notion d’attachement au terroir. Mais ils ont également la possibilité de scinder leur exploitation en fonction du niveau qualitatif de production. Ils espèrent de cette façon pouvoir transférer les bénéfices générés par une filière plus rentable vers l’élaboration de produits résultant d’une recherche d’adéquation avec leur terroir. Beaucoup de vignerons interrogés proposent ainsi une gamme de vins variée, allant du vin en vrac à 2 euros le litre à la bouteille haut de gamme à une quinzaine d’euros. De l’avis de l’un deux, qui souhaite orienter son exploitation vers une marche à deux vitesses, « tous les grands cuisiniers possèdent une brasserie, il faut donc faire de la brasserie et de la grande cuisine, mais sans les mélanger ». D’autres viticulteurs confient vouloir diversifier leurs activités pour subvenir à leurs besoins.
Bien souvent plusieurs de ces choix doivent être adoptés dans le souci de préserver une production de qualité.
Malgré tout l’AOC occupe une place de choix au sein de la commune de La Caunette, mais comme cela a été abordé, c’est grâce à la mise en place d’une appellation à deux vitesses, permettant d’empiéter sur les limites fixées par son cadre législatif.
III-2 : Différenciation de plusieurs ensembles |
Le chapitre suivant s’inscrit dans une recherche de singularités dans le territoire de La Caunette. Cela est entrepris dans le but d’isoler des entités particulières qui seront appelées unités de terroirs et d’analyser leur mise en valeur au travers des actions des acteurs principaux des paysages viticoles, les viticulteurs.
III-2.1 : Méthode d’interprétation
Dans cette recherche d’entités singulières, une méthode d’analyse du territoire doit être adoptée. Pour cela l’outil cartographique élaboré précédemment va être utilisé. Une fois la procédure d’analyse choisie, le travail va consister à rendre le SIG statistiquement exploitable dans une optique d’analyse bien précise. Cette action a pour but de pouvoir rendre mathématiquement exploitables les cartes du SIG.
2.1.a : La place des sols dans le choix des parcelles
Le premier travail d’analyse proprement dit se traduit dans la réalisation d’une nouvelle carte résultant du croisement de deux types de données.
Cette action permettra de donner une nouvelle orientation à cette étude. Le but est d’adopter ici une position servant de point de départ à la caractérisation d’unités de terroirs.
La superposition des cartes et les connaissances acquises jusqu'à présent, permettent d’avancer une première piste. La nature du sol est prépondérante dans la culture de la vigne. Cela n’est certes pas une découverte et il est logique, évident même, de penser que le choix du sol est déterminant dans la culture d’une parcelle de vigne. Mais en voir l’expression sur une carte est autre chose. Et c’est ce que l’on constate lorsque le maillage cadastral figurant les cépages est superposé à la représentation des types de sols.
Le premier constat se trouve dans la localisation des parcelles cultivées. La majorité de celles-ci sont situées dans le secteur est sud-est, comme cela a été écrit plus haut, mais cette concentration est liée à un sol particulier. On constate ici que la plupart des parcelles cultivées de cette zone reposent sur un sol marneux brun calcaire résultant lui-même de l’altération de son substrat, les marnes gréseuses.
Les autres portions de vigne formant cette majorité reposent sur un autre sol, qualifié de rendzine brunifié, sur des calcaires tendres. Ces deux sols supportent la très grande majorité des vignes de la commune.
Le troisième type de sol a être particulièrement propice à la viticulture, et c’est là que le phénomène est le plus marqué (cf. fig.7-III), est marneux aussi, mais d’origine laguno-marine. Il s’agit d’une étroite et sinueuse bande de terre constituée d’un sol brun calcaire s’étirant sur plus de treize kilomètres entre les sols sur calcaires durs au nord et tendres au sud. Elle n’est interrompue qu’à deux reprises. Dans sa largeur la plus grande, au lieu-dit appelé « Rec de Conques », elle ne fait pas plus de trois cents mètres et sa largeur moyenne se situe autour d’une soixantaine de mètres. Tout au long de celle-ci, se trouvent des parcelles de vignes. Plus d’une soixantaine y sont dénombrées (soixante-deux exactement).

Fig. 7-III. Capture d’écran du SIG « projet_terroir »
Les sols sur calcaires durs et schistes sont quant à eux presque dépourvus de vignes. On remarque toutefois la présence de quelques parcelles près du hameau de La Garrigue sur un sol brun acide reposant sur des schistes. La viticulture y est donc possible. Les sols reposants sur les calcaires durs, dit rendzine, rouge fersalitique, supportent eux aussi quelques exceptions. Mais la très faible épaisseur du sol (lithosols) et le niveau de compaction de la roche sous jacente apparaissent comme des facteurs limitant pour le bon développement du cep de vigne. Des soins particuliers seront donc nécessaires pour assurer un bon développement de cette culture.
Plus au sud, rive droite de la Cesse, sont présents trois autres types de sols, qui semblent eux aussi attirer plus ou moins bien la vigne. Le secteur le plus marqué est celui abritant un sol brun calcaire résultant de la dégradation de colluvions et alluvions. Les parcelles de vignes y sont là concentrées. Bien que reparti en trois zonages distincts, ce sol accueille très favorablement la vigne, à en juger par le peu d’espaces laissés vierge de cette plante.
Il s’en suit un sol constitué d’alluvions déposés là par la Cesse, qui creusa son lit progressivement, celui-ci est qualifié de sol rouge fersalitique. Il ne se démarque pas des autres par un fort encépagement, malgré un décalage constaté entre notre représentation et la réalité du terrain, causé par un manque de données (vraisemblablement car les viticulteurs de ces parcelles ne faisaient pas partie de ceux choisis pour les entretiens).
La nature du sol étant visiblement un facteur déterminant dans la répartition spatiale des vignobles, elle servira de fil conducteur à la caractérisation d’unités de terroirs. De cette façon l’environnement de la vigne sera analysé en fonction du type de sol.
2.1.b : Reclassification, vectorisation et croisements de données
Là où une simple superposition de l’encépagement sur la carte des sols, des pentes, d’ensoleillement ou d’orientation suffisait, il est à présent nécessaire, à cause du changement d’échelle, d’entrer plus en profondeur dans l’analyse de ces données. L’étendue géographique propre à chaque sol devra donc être isolée et les diverses informations contenues par le modèle cartographique lui correspondant le seront également.
La première couche d’information à subir ce traitement est logiquement celle contenant le parcellaire associé à la base de données commune aux cépages et porte-greffes. Le but est donc d’isoler et de regrouper les parcelles dont le sol est semblable. Pour cela, le logiciel Arcview est parfaitement adapté. Une fois la surface représentant un même sol sélectionnée sur la carte géo-pédologique, et grâce à la fonction « Sélectionner par entités », les parcelles se rapportant à cette sélection sont ainsi mises en évidence. A noter que plusieurs méthodes pour ce faire sont possibles, en sachant qu’une parcelle à cheval sur deux sols ne pouvait être coupée facilement, il a été choisi, après plusieurs essais, de prendre en compte les parcelles dont l’orthocentre était inclus dans l’étendue sélectionnée. Une fois ce groupe de parcelles isolées (menu « sélection » puis « créer une couche à partir des entités sélectionnées ») et sauvegardées, un fichier cartographique cadastral propre à chaque type de sol est obtenu. La base de données étant associée à ce fichier, le traitement statistique permettant de mettre en évidence la prédominance de cépages ou de porte-greffes en fonction des sols, s’en trouve à présent grandement simplifié.
Dans l’optique d’une plus grande précision dans la description des secteurs isolés, et particulièrement dans le cas des pentes et des expositions, certaines cartes doivent subir un traitement particulier. Le problème réside dans le fait que les cartes qualifiées de fichiers image, c'est-à-dire représentant des informations exploitables que visuellement, sans base de données associée, ne permettent pas une description poussée sur la moyenne des pentes ou les expositions.
La solution est alors apportée par la conversion des fichiers image en fichiers vecteur. Cette technique est appliquée aux deux cartes citées précédemment. Il s’agit de la technique de reclassification. Le principe étant de transformer les classes correspondant à un intervalle de pente ou à une exposition en leur attribuant une valeur unique, par exemple : 1 pour les pentes comprises entre zéro et trois degrés, 2 pour la classe supérieure, et ainsi de suite. Une fois la nouvelle carte obtenue, on peut convertir le fichier raster (image) en fichier vecteur. Le logiciel crée alors automatiquement des polygones qui remplacent chaque zone couverte par une même valeur. Le résultat obtenu est une carte d’entités, associant une base de données à laquelle des informations spatiales peuvent être ajoutées (périmètre et superficie).
L’opération d’extraction décrite plus haut peut alors débuter, à la différence prés que le fichier vectoriel est au préalable intersecté avec celui des sols. Les entités et bases de données sont ensuite isolées automatiquement en fonction de chaque type de sol.
Une fois ces opérations réalisées, les données sont aisément exploitables sous forme de tableaux et de graphiques. Pour cela, le logiciel Excel a été préféré à l’éditeur de graphiques inclus dans Arcmap pour des raisons pratiques. La base de données doit donc être exporté si besoin (car elle n’est pas automatiquement générée dans le cas des deux cartes précédemment évoquées) afin de les utiliser sous Excel (le fichier d’export est un « .dbf », donc compatible avec Excel). L’édition de tableaux et graphiques peut ensuite commencer.
Ces opérations expliquent la présence de fichiers de type –en prenant exemple sur la carte des pentes- « Pentes_Vecteurs » ou « Pentes_sols_Vecteur » dans le complément cartographique sur le CD-ROM « projet_terroir ». La première dénomination correspond au fichier d’origine « Pentes_Raster » converti en mode vecteur, et la seconde fait référence aux fichiers correspondant aux croisements du fichier vecteur initial et des entités correspondantes à chaque type de sol. On obtient ainsi un fichier de type vecteur indiquant toutes les pentes observables sur l’étendue couverte par un même sol. Le terme « pentes_sol_marnes_laguno » correspond donc aux pentes qui sont associées au sol sur marnes laguno-marines. Le principe est le même pour les données propres aux altitudes. En ce qui concerne les expositions, la procédure diffère quelque peu, il a été choisi de conserver entiers les versants du relief, le résultat n’est donc graphiquement pas le même. La méthode employée permet de sélectionner les expositions dont l’orthocentre est inclus dans l’entité de sol.
A noter que cette démarche n’est pas appliquée à la carte du bilan radiatif, car sa faible résolution permet une analyse visuelle par superposition, ni à la carte géologique pour des raisons de superposition des sols et de leurs substrats.
2.2.a : Le terroir sur schistes
Ce terroir est très peu utilisé en viticulture dans la commune, en grande partie en raison de son altitude élevée, toutefois, un ensemble de parcelles de Marssanne, Rousanne et Syrah est présent aux abords du hameau de la Garrigue. Cette analyse sera ciblée sur les alentours de cette zone cultivée.
Le sol de se territoire prend appui sur une roche métamorphique, caractérisée par une forte schistosité. Son sol est dit brun acide, d’une profondeur variant entre 80 et 120 cm composé d’une grande proportion d’éléments grossiers schisteux.
Cette zone est la plus humide du territoire communal, les précipitations y sont supérieures à 700mm par an.
Le bilan radiatif se situe autour de 34000 Kj/m²/jours durant le cycle végétatif de la vigne. Cette humidité, cette altitude -près de 400m- et cet ensoleillement modéré peuvent néanmoins êtres compensées en partie par la capacité qu’a le sol à emmagasiner la chaleur, du fait de sa forte teneur en fer et en aluminium.
Ce sol est intéressant pour la viticulture car il apporte aux produits issus des vignes une forte empreinte de typicité, notamment en raison de sa forte acidité.
Les pentes qui caractérisent cet espace sont très variables, en raison du relief accidenté des collines schisteuses. Plus précisément, le secteur de la Garrigue présente de très faibles pentes, comprises entre zéro et sept degrés.
Les cépages de ce terroir sont associés au porte-greffe 110 Richter, qui possède une vigueur nécessaire et suffisante à un bon développement de la vigne, et semble bien approprié à ce sol. Bien que la vigne en question soit jeune, la Syrah qui peut craindre une trop grande sécheresse devrait pousser dans de bonnes conditions climatiques. Un palissage et une conduite bien étudiées sont par contre nécessaires pour faire face aux vents violents qui peuvent balayer la zone.
L’exposition dominante autour de la Garrigue varie entre l’Est, le Nord-Est et des zones planes.
La réserve hydrique du sol est plutôt faible (60 à 80mm), et interdit de forts rendements. Mais l’intérêt de cultiver de la vigne sur ce sol est justement lié à un souhait de qualité élevée, bien souvent conditionnée par de faibles rendements.
Malgré des conditions climatiques pouvant limiter l’implantation de la vigne, le terroir sur schistes est singulièrement différent des autres terroirs de la commune. Ce qui en fait, en plus de ses caractéristiques édaphiques spécifiques, un terroir potentiellement hautement qualitatif. Il peut être perçu comme un véritable terrain d’expérimentation viticole pour les tenants d’une viticulture fondée sur la notion de terroir.
2.2.b : Le terroir sur calcaires durs
Il s’agit là du second terroir à supporter très peu de vignes. Les trois principaux cépages de la commune y sont tout de même représentés.
Le sol rouge fersiallitique, appelé rendzine est squelettique (une dizaine de centimètres d’épaisseur), il repose sur une roche mère, souvent à nu, de calcaires durs d’origine biodétritiques. Ce substrat est parcouru de fissures, altérations provenant du climat.
Les conditions climatiques baignant ce terroir sont sensiblement les mêmes (autour de 700mm de précipitations) que celles du terroir sur schistes à l’exception de sa bordure occidentale qui plonge vers le sud pour ne s’arrêter qu’aux abords du village de La Caunette, bénéficiant ainsi d’une influence climatique plus sèche.
Le bilan radiatif est élevé (de 34300 à plus de 34630Kj/m²/jour). C’est le domaine du Causse calcaire. Il a la forme d’une grande dalle légèrement inclinée, de zéro à six degrés, traversée en son centre par les profondes gorges du Tréménal.
L’altitude caractérisant ce territoire est fournie par l’histogramme suivant. Chaque code d’altitude correspond à une classe. Le codage vient de l’opération de reclassification.
Classes d’altitudes du terroir sur calcaires durs

Fig.8-III
Ce terroir est donc caractérisé par une élévation moyenne comprise entre les codes 22 et 27 qui correspondent à un intervalle de 295 à 368 mètres.
Malgré un niveau de précipitation élevé, la gestion de l’eau pose problème, principalement à cause de la faible réserve en eau du sol. Les fissures du substrat devront êtres colonisées par l’appareil racinaire du porte-greffe pour qu’il puisse y puiser les eaux d’infiltrations et nourrir ainsi le cep durant la période estivale.
Les seules parcelles figurant sur le SIG et situées sur ce terroir, sont classées en AOC ou en Vin de Pays, ce qui peut permettre de croire au caractère original de ce terroir en viticulture. Mais la valorisation de ce terroir passe par la réalisation de travaux conséquents sur la préparation du sol (au risque de provoquer une augmentation du taux de calcaire actif).
L’implantation de vignes doit se faire par un choix judicieux de cépages et porte-greffes, qui doivent pouvoir se contenter d’un sol mince et d’une roche sous jacente massive. La préparation peut néanmoins augmenter la profondeur du sol.
2.2.c : Le terroir sur marnes laguno-marines
Ce terroir est sans aucun doute le plus exploité de tous, non pas par sa surface en vignes, mais par sa proportion entre vignes et sols libres. Le vignoble occupe près de 40 % de ce terroir. Cette proportion est de plus en deçà de la réalité étant donné que les informations sur l’encépagement récoltées n’ont pas un caractère exhaustif.
Ce territoire est situé en limite de climat méditerranéen strict, les précipitations sont donc faibles. L’altitude moyenne relevée varie entre 240 et 350 mètres. Les expositions sont très variables mais font rarement face au sud. Malgré cela, ce terroir bénéficie d’un bilan radiatif élevé (à l’exception de sa partie de territoire localisé dans l’extrême est de la commune).
Nous l’avons vu, ce terroir est caractérisé par un sol s’étendant sur une étroite bande ceinturant les calcaires tendres. Le sol y est profond, souvent plus d’un mètre. Sa structure lui offre une capacité de rétention d’eau importante (autour de 80mm/m). Il s’agit là d’un atout non négligeable dans cette région marquée par de fortes sécheresses estivales. Sa profondeur en fait de plus un terrain d’enracinement idéal pour les porte-greffes.
Mais ce type de sol présente certaines contraintes pour la viticulture. La structure de celui-ci le rend sensible à l’érosion non pas éolienne, vu le caractère non volatile de ses composés, mais celle due aux pluies. Celles-ci ont beau être rares, elles n’en sont pas moins violentes, et les quelques pluies d’orages de printemps ou d’automne charrient de grandes quantités de matériaux. La culture de la vigne laissant généralement le sol nu, le déplacement de matériaux y est d’autant plus important (et proportionnellement lié à l’inclinaison de la parcelle) malgré l’implantation de rangées perpendiculaires au sens de la pente. Ces pentes sont une constante sur ce type de sol, elles sont modérées, mais partout présentes. La méthode employée pour déterminer l’altitude est employée pour réaliser la figure qui suit, cela afin de vérifier l’inclinaison générale de ce terroir.
Le terroir sur marnes laguno-marines : répartition des pentes

Fig. 9-III Source DB « projet_terroir »
Cet histogramme prouve effectivement que les pentes observables sur ce terroir sont faibles à moyennes, les codes en ordonnées correspondant aux intervalles de pente de la carte « Pentes_raster » du CD-ROM (3 à 4 correspond à 6.5 à 16°).
Ainsi, les pentes accentuent les phénomènes d’érosion et les bas de pentes sont petit à petit vidés des matériaux qui constituent leurs sols. Ils sont entraînés par les eaux de ruissellement et rejoignent les ruisseaux des alentours. Ce phénomène s’accentue pendant les périodes durant lesquelles les sols sont dénudés.
Au fil du temps les matériaux constitutifs du sol s’accumulent donc en bas de pente s’ils sont stoppés par un obstacle, mais rejoignent les ruisseaux si rien ne les arrête. L’illustration de ce phénomène est dans la parcelle de 54 ares, référencée AB 112b, située au Rec de Conques, caractérisée par une pente douce (autour de 14°) orientée au nord-est. Dans la partie haute, la profondeur du sol est de l’ordre d’un mètre cinquante, alors que quelques mètres plus bas, elle n’atteint qu’une cinquantaine de centimètres. Ces chiffres ont pu être estimés lors d’une opération de ripage (hiver 2005), qui consiste à préparer le sol dans l’optique de recevoir un nouvel encépagement.
Les cépages et leurs porte-greffes que l’on peut trouver sur ce terroir sont représentés dans la figure 10-III.
Le terroir sur marnes laguno-marines, cépages, porte-greffes et appellations

Fig. 10-III Source DB « projet_terroir »
L’AOC est ici très bien représentée, le porte-greffe 110 Richter est, comme à l’échelle de la commune, associé à tous les cépages. L’association intéressante, dont il a déjà été question au chapitre III-1.2, est celle de la Syrah et du 140 Ruggieri. Elle doit être réalisée avec un suivi régulier, mais peut donner une production d’une grande qualité.
Après consultation du SIG « projet_terroir », il s’avère que les sept parcelles regroupant ces deux variétés sont toutes localisées dans les environs immédiats du hameau du Cazal. En recoupant ces informations aux entretiens (cf. II-2.2), il apparaît que l’exploitant en question, héritier d’un domaine multiséculaire, fait pratiquer des analyses approfondies des sols, accompagnées de fosses pédologiques, afin de déterminer au mieux les variétés à utiliser. Ce domaine se veut inscrit dans une démarche très qualitative, ne produisant que de l’AOC, intégrant une approche scientifique poussée du terroir. L’association de cette approche à une connaissance de la viticulture issue de plusieurs siècles d’archives, permet à ce viticulteur l’élaboration d’un produit empreint d’une puissante marque de ce terroir.
Mais cette viticulture a un prix, et quelques mètres plus loin apparaît une parcelle sur laquelle sont associés Grenache noir et SO4. Cet exemple abonde dans le sens d’une dynamique de diversification décrite plus haut (cf. III-1.3). L’idée est renforcée par le caractère récent de cette plantation (2003).
Les abondantes informations fournies par ce vigneron permettent d’expliquer une autre association, celle du Carignan noir et du Rupestris du Lot, porte-greffe réputé peu qualitatif et de moins en moins utilisé. Elle se justifie justement par son âge, qui se chiffre à plus de soixante-dix ans. C’est en effet là un témoin des tendances à la surproduction dans la viticulture des années trente, bien avant la grande réflexion nationale qui aboutira à la mise en place des AOC.
Ce terroir offre donc de remarquables atouts à la culture de la vigne mais exige une préparation et un suivi adaptés aux contraintes qui lui sont liés.
2.2.d : Le terroir sur calcaires tendres
Ce terroir est le plus vaste de la commune, il regroupe à lui seul plus de la moitié des parcelles référencées dans la base de données de l’encépagement, soit plus de 100 hectares sur 250.
Son sol repose sur un substrat calcaire qui doit sa tendreté à une forte proportion d’argile. Le type de sol est dit rendzine brunifiée à sol brun caillouteux. Sa profondeur varie entre 50 et 70 cm, ce qui aide à un meilleur enracinement que sur le calcaire dur. Il est caractérisé par une proportion importante en éléments grossiers et une réserve en eau variant entre 40 et 80mm/m en fonction de sa positon topographique. Bien que sa structure puisse faire obstacle à un enracinement profond, car gêné par les blocs de calcaires à faible profondeur, son dépassement peut permettre au porte-greffe de puiser en profondeur l’eau nécessaire à une alimentation du cep en période estivale.
La superposition de la carte de ce sol à celle du bilan radiatif montre que ce territoire bénéficie d’un ensoleillement remarquable, allant de 34370 Kj/m²/jour à plus de 34600. Seules quelques secteurs à l’est et au sud-ouest de cet espace affichent un bilan radiatif médiocre.
Ce niveau d’énergie reçue doit son importance à l’inclinaison et l’orientation générales de ce terroir.
Le terroir sur calcaires tendres : répartition des pentes

Fig. 11-III Source DB « projet_terroir »
L’inclinaison observée ici est faible à moyenne, la classe 2 correspondant à un intervalle de 3 à 6.5 degrés.
L’exposition globale est à l’image de la pente, aisée à décoder. La figure suivante nous en donne la preuve :
Le terroir sur calcaires tendres : orientations des pentes

Fig. 12-III Source DB « projet_terroir »
L’orientation dominante, correspondant aux codes 5 et 6, va du sud-est au sud. Ceci explique le niveau du bilan radiatif. Le présence de zones planes est remarquée ici (codée 1). Elles annoncent le passage à un autre terroir, celui des marnes gréseuses, dont la limite est matérialisée par le Tréménal.
L’altitude, quant à elle est très variable, elle est comprise entre 150 et 305 mètres. Elle n’est pas un facteur limitant pour l’implantation de la vigne.
L’encépagement de ce terroir est assez complexe, l’appellation Minervois y est dominante mais les vins de Pays sont bien représentés. Les cépages représentant ces derniers sont très variés, une dizaine d’entre eux est dénombrée. Cette diversité est un atout revendiqué par certains producteurs qui misent sur un produit complexe et abordable à la fois.
Le terroir sur calcaires tendres : encépagement

Fig. 13-III Source DB « projet_terroir »
Mais cette diversité est-elle vraiment mise en valeur ? Là encore, la large place occupée par le 110 Richter permet d’en douter. Sa présence peut être expliquée par un taux de calcaire actif dans le sol potentiellement élevé. Ce dernier justifie également le recours au 140 Ruggieri sur la Syrah, le Muscat petit grain ou le Macabeu. Les cépages des vins de Pays sont dans ce cas caractérisés par une variété élevée, aussi bien pour les cépages qu’en terme de porte-greffes.
L’AOC est marquée par une domination de ses trois principaux cépages, comme sur la majorité des sols de la commune. La présence de Grenache blanc est notée, il s’agit d’une des rares parcelles de blanc classée en AOC. L’autre changement est caractérisé par une prédominance du Grenache, qui s’efface habituellement au profit du Carignan. Cette domination reste vraie, et s’accentue même, lorsque les cépages sans porte-greffes connus sont pris en compte. Cette dernière opération permet également de s’apercevoir d’une plus grande diversité au sein même de cette appellation. Trois cépages viennent alors s’ajouter à la représentation de la figure 13-III.
Il est important de noter, pour finir, que ce territoire est fragmenté en trois parties distinctes, la plus vaste constitue une partie du Causse calcaire, sur la rive gauche de la Cesse. La seconde est localisée rive droite, au sud sud-est du territoire communal. Son altitude -180 à 220 mètres- est inférieure à celle de Causse. Cela s’explique par le passé mouvementé du cours d’eau qui a participé à l’aplanissement de cette zone pour progressivement creuser son lit et isoler ainsi ces deux parties. La dernière unité constitue la zone sommitale -250 à 290 mètres- du versant nord de la rive droite.
L’encépagement de tous ces secteurs est sensiblement le même. L’unité occidentale se démarque néanmoins par une orientation principalement septentrionale.
Ce terroir semble donc accepter une plus grande variété de cépages, favorisant ainsi la complexité du produit final. Mais le sol semble limiter la diversité des associations cépages/porte-greffes.
2.2.e : Le terroir sur marnes gréseuses
Voici le second terroir le plus utilisé en viticulture, plus de 80 hectares de vignes y sont plantés.
Son sol repose donc sur une marne gréseuse d’origine sédimentaire constituée d’argile et de calcaire. Le paysage associé est composé d’une succession de collines à grès (puechs) et de marnes gréseuses formant des cuvettes. Le sol associé est dit brun calcaire, son épaisseur est variable. Il est squelettique aux abords ou sur les puechs, et peut être profond d’un mètre ou plus en position de bas de versant. Ce sol, du fait de cette variabilité, présente une réserve hydrique très fluctuante, fonction de la pente, mais qui peut atteindre 80 mm/m en bas de versant.
Le climat qui domine est, bien sûr, de type méditerranéen strict mais peu être atténué par des effets liés au relief.
Une des singularités de ce terroir est sa partition en deux unités distinctes. Rive gauche de la Cesse se trouve un premier secteur, qui s’étend du cours d’eau jusqu’à Vialanove en passant par Babio. Rive droite, la seconde partie occupe tout le versant nord qui fait face au village de La Caunette.
Cette dernière unité se caractérise par un faible bilan radiatif, une pente moyenne à forte (9 à 26 degrés) ainsi qu’une présence d’anciennes terrasses, de faible superficie, utilisées autrefois pour diverses cultures. Ces données rendent ce lieu peu propice au développement d’une viticulture moderne. Quelques parcelles de vignes y sont malgré cela dénombrées. Ces dernières sont toutes ou presque, classées en AOC. Cet environnement spécifique, sensé être peu propice à la vigne, est vraisemblablement garant d’une certaine typicité du produit final.
L’unité de Babio, quant à elle, concentre les parcelles de vignes aux alentours des hameaux, dans les dépressions de marnes. Les cépages présents sont inscrits dans la figure suivante.
Le terroir sur marnes gréseuses : encépagement

Fig. 14-III Source DB « projet_terroir »
Premier constat : c’est sur ce sol que l’on trouve le plus de vin de Table. Celui-ci est composé de cépages classiques, s’alliant avec un 110 Richter omniprésent et un 99 Richter.
Les parcelles en vin de Pays marquent leurs singularités par les cépages Tempranillo noir et Merlot noir. La présence de SO4 est le témoin d’une volonté de rendements élevés, peu limités par le cadre de cette appellation.
En ce qui concerne l’AOC, un paradoxe dans la culture de la Syrah est relevé ; en effet, l’idée de cet appellation ne semble pas aller dans le sens d’une association Syrah/SO4, porte-greffe qui n’est pas réputé pour son apport qualitatif au fruit, mais qui amène la vigne à d’important rendement. Cependant le cadre juridique de cette AOC n’empêche en aucun cas ce genre d’association.
Ce terroir est donc très contrasté, et son exploitation par l’homme marquée par la diversité.
Mais cette diversité peut être expliquée, non seulement par la nature du sol, mais aussi par l’expression des objectifs de rendements des viticulteurs.
Les terroirs qu’il reste à décrire sur le territoire de La Caunette sont au nombre de trois. Ils sont tous issus de formations géologiques récentes. Les matériaux qui les composent se sont accumulés soit par le biais d’un cours d’eau, soit par gravité en bas de pente ou encore à la faveur d’une régression glacière. Ces terroirs sont inscrits dans des espaces restreints, si bien que leur analyse est groupée.
Le terroir sur éboulis, même s’il ne supporte pas un nombre significatif de parcelles de vignes, nécessite une description sommaire.
Sa constitution a pour origine une accumulation d’éclats calcaires gélifractés. Le sol est généralement très profond (plus de 1.5 mètres). Sa composition permet un enracinement efficace et lui permet une réserve d’eau significative (80 à 100mm/m). De plus, sa position de bas de versant nord, sur la rive droite de la Cesse, favorise une limitation des effets arides du climat. Ainsi, des greffons sensibles à la sécheresse pourront mieux pousser dans cette zone que partout ailleurs sur le territoire communal. L’exemple traduisant le mieux de cette association est celui, déjà évoqué, de la parcelle de Grenache noir greffé à un 41B, réputé sensible à la sécheresse. Ce choix semble être très précisément adapté à ce terroir.
Les sols sur colluvions et alluvions récents forment un second terroir. Celui-ci est caractérisé par un sol profond constitué d’éléments charriés par les cours d’eau ou les eaux de ruissellement. La réserve hydrique de ce sol peut être très importante (plus de 120mm/m). La seule contrainte liée à l’eau peut provenir d’un excès. Localisé rive droite de la Cesse, ce terroir reçoit une quantité d’énergie solaire peu élevée durant le cycle végétatif de la vigne. La pente y est faible voire nulle. L’encépagement de ce terroir, bien qu’il soit réduit, est en totalité classé en AOC. La Syrah domine très largement ce terroir. L’observation de pratiques viticoles soignées accompagnées d’une conduite de la vigne bien mesurée laisse penser que la mise en valeur raisonnée de ce sol est un gage de qualité.
Le dernier espace dont il est question est localisé de part et d’autre de la Cesse. Il est divisé en deux terrasses alluviales formées par le cours d’eau lors du creusement progressif de son lit. Le sol de ce terroir est rouge fersialitique plus ou moins décarbonaté. Il est là encore d’une profondeur importante et d’une réserve hydrique variant entre 60 et 100 mm/m. La base de données « projet_terroir » ne recense que trois parcelles sur ce sol. L’analyse de l’encépagement n’est donc pas pertinente. Néanmoins, aux dires de plusieurs viticulteurs, ce terroir prodigue au produit qui en est issu une identité spécifique. De plus c’est sur ce même terroir que Syra et 333EM ont été associés.
Il apparaît au travers des analyses effectuées sur les différents terroirs de La Caunette, plusieurs enseignements. En premier lieu, les terroirs qui ont été déterminés sont non seulement basés sur un certain sol (par la méthode choisie), mais s’avèrent renfermer certaines spécificités qui leurs sont propres. Au-delà de cela, il a été constaté que la mise en valeur de ces particularités, à de rares exceptions près, n’était pas réalisée.
CONCLUSION |
Alors que cette étude touche à sa fin, il convient de récapituler les idées qui ont été développées ainsi que les avancées obtenues. Le problème initial consistait à s’interroger, sur fond de crise viticole, attisée par l’arrivée de vins d’un nouveau genre, dit de marque, formatés artificiellement, sur la validité de notre concept d’appartenance géographique.
Le travail a été effectué à l’échelle d’un territoire restreint, inscrit dans un passé viticole fort d’un âge plurimillénaire. Cette notion d’attache étant étroitement liée à celle de terroir, il a été entrepris de mettre en place une méthode étayée par des outils pour tenter de trouver, d’analyser et de caractériser le ou les terroirs de ce territoire.
Le recours à la numérisation des données géographiques propres à l’environnement de la vigne s’est alors avérée très utile. L’utilisation d’un tel outil cartographique dans la recherche d’unités de terroir s’est révélée pertinente.
La complémentarité apportée par un outil propre aux sciences sociales a alors marqué un tournant dans ce développement.
Selon les résultats obtenus, il apparaît clairement que le territoire de La Caunette possède certaines aptitudes pouvant permettre aux hommes à travers une mise en valeur adaptée, d’en tirer des produits spécifiques d’une grande qualité.
Mais la juxtaposition des deux outils d’analyse a mis en évidence l’inadéquation fréquente entre le mode de mise en valeur choisi et les potentialités des sols.
Force est de constater qu’une protection des terroirs par le biais de l’appellation d’origine contrôlée, n’en garantie pas l’optimisation.
Il est a déplorer que rien n’incite le vigneron à produire 42h/ha alors qu’il a le droit d’en produire 45, voire 50. Ni même de choisir d’associer une Syrah avec un 161.49 bien que le SO4 génère un rendement plus élevé, cela engendrerait pourtant une élévation de la qualité. Mais même s’il choisit de privilégier la qualité plutôt que la quantité, il n’est pas certain des résultats. Il sera alors dans l’obligation de diversifier ses activités, de scinder son exploitation en deux parties, l’une rentable produisant un vin médiocre, l’autre non rentable produisant un vin de qualité. Mais cette dernière possibilité ne peut tenir longtemps, car même les vins bas de gamme sont touchés par la concurrence du marché international.
Une autre solution consisterait à établir un nouveau cadre de production, matérialisé par une AOC de zone, beaucoup plus restrictive. Mais pour cela, il faudrait que les vignerons eux-mêmes soient intéressés. Or des tentatives ont déjà été esquissées à La Caunette, qui ce sont révélées sans succès. Le passé viticole, ancré dans cette commune, qui en fait sa richesse, est également sa faiblesse. Les héritiers de celui-ci sont souvent dans un certain immobilisme, car prisonniers de leur histoire.
La subvention massive d’une AOC pourrait appâter bien des viticulteurs, mais cela conduit à un autre paradoxe, celui d’élaborer un produit dont le prix de fabrication est plus élevé que celui de vente. A l’image d’une grande partie de l’agriculture française.
Une des seules choses qui pourrait participer à un changement de cap, si ce n’est toutes les hypothèses précédemment citées, c’est une prise de conscience du viticulteur. Qu’il prenne conscience que ses actes ont une portée collective, et non individuelle.
En attendant, il convient d’étudier plus en profondeur les comportements à adopter par les vignerons soucieux d’évoluer dans une démarche de qualité. Dans ce but, l’outil mis en place dans le cadre de cette année de maîtrise peut s’avérer très utile. Des informations précises sur l’expression de la conduite de la vigne dans le produit final peuvent y être ajoutées. Ces données peuvent être de nature bien diverses, il peut s’agir du référencement des analyses de sols, des relevés climatiques, les modes de conduites, et éventuellement des caractéristiques du produit final.
Une autre application de cet outil pourrait être exploitée : la mise à disposition d’un cadastre évolué au plus grand nombre. Ainsi tout propriétaire ou utilisateur d’une parcelle pourrait facilement avoir accès à toutes ces informations depuis la Mairie, ou même sur Internet.
De plus, le caractère évolutif du projet, qui est un principe fondamental du SIG, et même un des intérêts de ce genre d’outil, en fait un produit intéressant pour les municipalités car facilement consultable et modifiable, donc durable.
BIBLIOGRAPHIE |
ARCHAMBAULT M, LHENAFF R., VANNEY J.R. – 1988 – « Documents et méthode pour le commentaire de cartes », Fascicules 1 et 2, Masson, Paris, 102 et 166p.
BRAUDEL F. – 1986 – « L’identité de la France. Les hommes et les choses II », Arthaud - Flammarion, Malesherbes, 477p.
DAHL R. - 1962 - « Bizarre ! Bizarre ! », Gallimard, col. Folio, Saint-Amans. 308p. pp. 9-25.
DION R. – 1959 – « Histoire de la vigne et du vin en France », BIUT, Paris, 767p.
FERRER J.P. - 1999 - « Précis chronologique d’histoire de La Caunette », coll. Les cahiers de Minerve, Montpellier, 126p.
GALET P. – 1998 – « Précis d’ampélographie pratique », Pierre Galet, Saint Jean de Védas, 226p.
GARRIER G. – 1999 – « Histoire sociale et culturelle du vin », Larousse, Manchecourt, 767p.
GEZE B. – 1979 – « Guides géologiques régionaux : Languedoc méditerranéen. Montagne Noire », Masson, Paris.190p.
HUETZ de LEMPS A. – 1977 – « Géographie historique des vignobles. Tome 1 : Vignobles français », CNRS, Bordeaux, 215p.
MORLAT R. – 2001 – « Terroirs viticoles: étude et valorisation ». Ed. Oenoplurimédia, Chaintré, 243p.
REZEAU P. – 1997 – « Le dictionnaire des noms de cépages de France », CNRS Editions, Paris, 422p.
RIGOLI S, RAMBAUD D. – 2003 – « Le patrimoine du Minervois et sa valorisation économique », programme Coordonné « Tourisme de terroir en Minervois », Syndicat du cru Minervois, Siran, 191p.
ROUGERIE G. - 1962 - « Systèmes morphogéniques et familles de modelés dans les zones arides », Edition: Paris : C.D.U , Collation: 167 p.
VAUDOUR E. – 2003 – « Les terroirs viticoles. Définitions, caractérisation et protection », Dunod, Paris, 294p.
VIDAL M. – 2001 – « Histoire de la vigne et des vins dans le monde. XIXé – Xxé siècle », Féret, Bordeaux, 175p.
VIERS G. – 1967 – « Eléments de géomorphologie », Nathan, Paris, 207p.
Syndicat du cru Minervois. Communes héraultaises, - 2003 – « Environnement naturel, Terroir naturel », Association climatologique de l’Hérault, 76p.
MOGENET M. – 1998 – « Les chemins de La Caunette. Un témoignage de la dynamique des paysages », Mémoire de Maîtrise de géographie, Université Paul-Valéry Montpellier III, 116p.
SKORA N, CALMET C. – 1999 – « Analyse de paysage sur la commune de La Caunette », Mémoire de Maîtrise de géographie, Université Paul Valéry Montpellier III. 134p.
Carte IGN, TOP25 2444 ET– 2002 – « Somail-Minervois »
ALABOUVETTE B, DEMANGE M. – 1993 – « Carte géologique de la France 1013, Saint-Pons », BRGM, Orléans.
BERGER G.M, BOYER F, REY.J. – 1990 – « Carte géologique de la France 1038, Lézignan-Corbières », BRGM. Orléans.
http://admi.net/jo/20040729/AGRP0401080D.html, Décret du 21 juillet 2004 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois ».
http://www.forumsig.org/index.php, Forum SIG - Systèmes d'Information Géographique.
http://eocene-corbieres.ifrance.com/geologie/geol.htm,
http://geographie.forumactif.com/, Forum consacré à la géographie.
http://environnement.ecoles.free.fr/ Vin/ACCUEIL.HTM, Les vins, la géologie et les terroirs.
http://www.onivins.fr/Vin/Reperes/HistoireCulture.asp, office national interprofessionnel des vins.